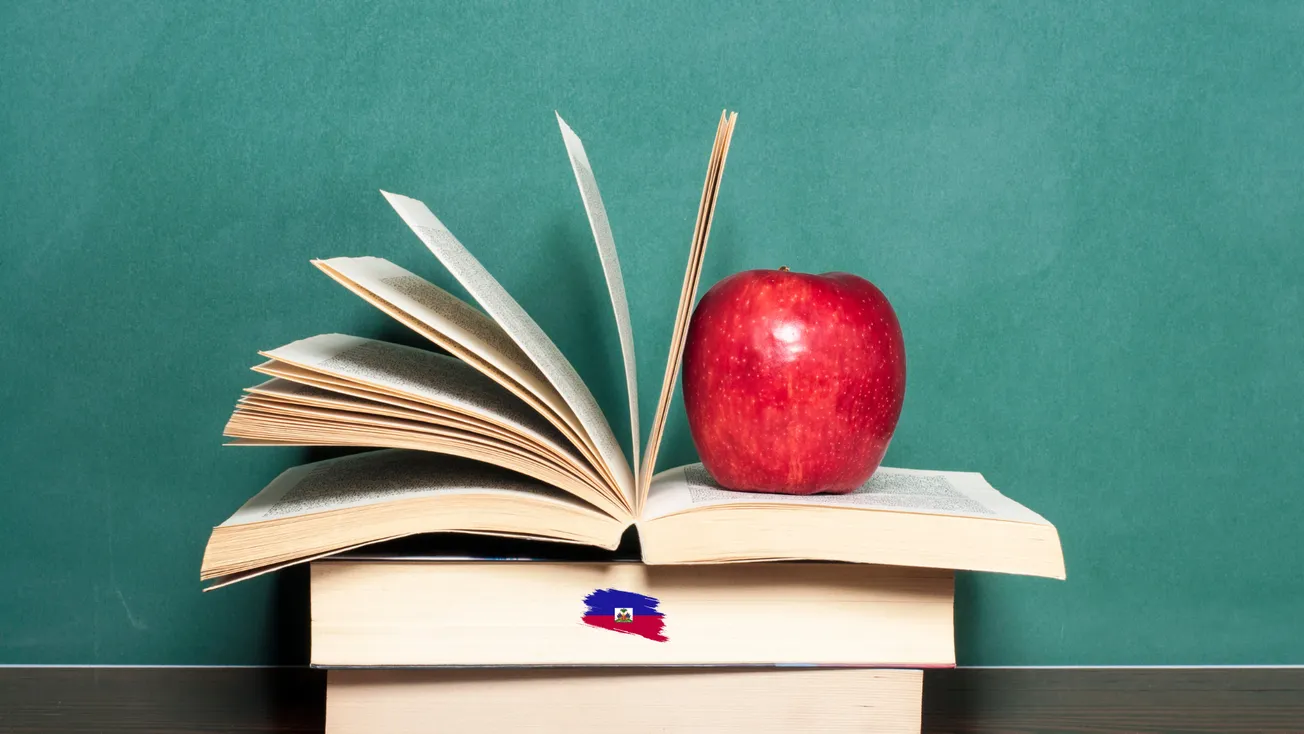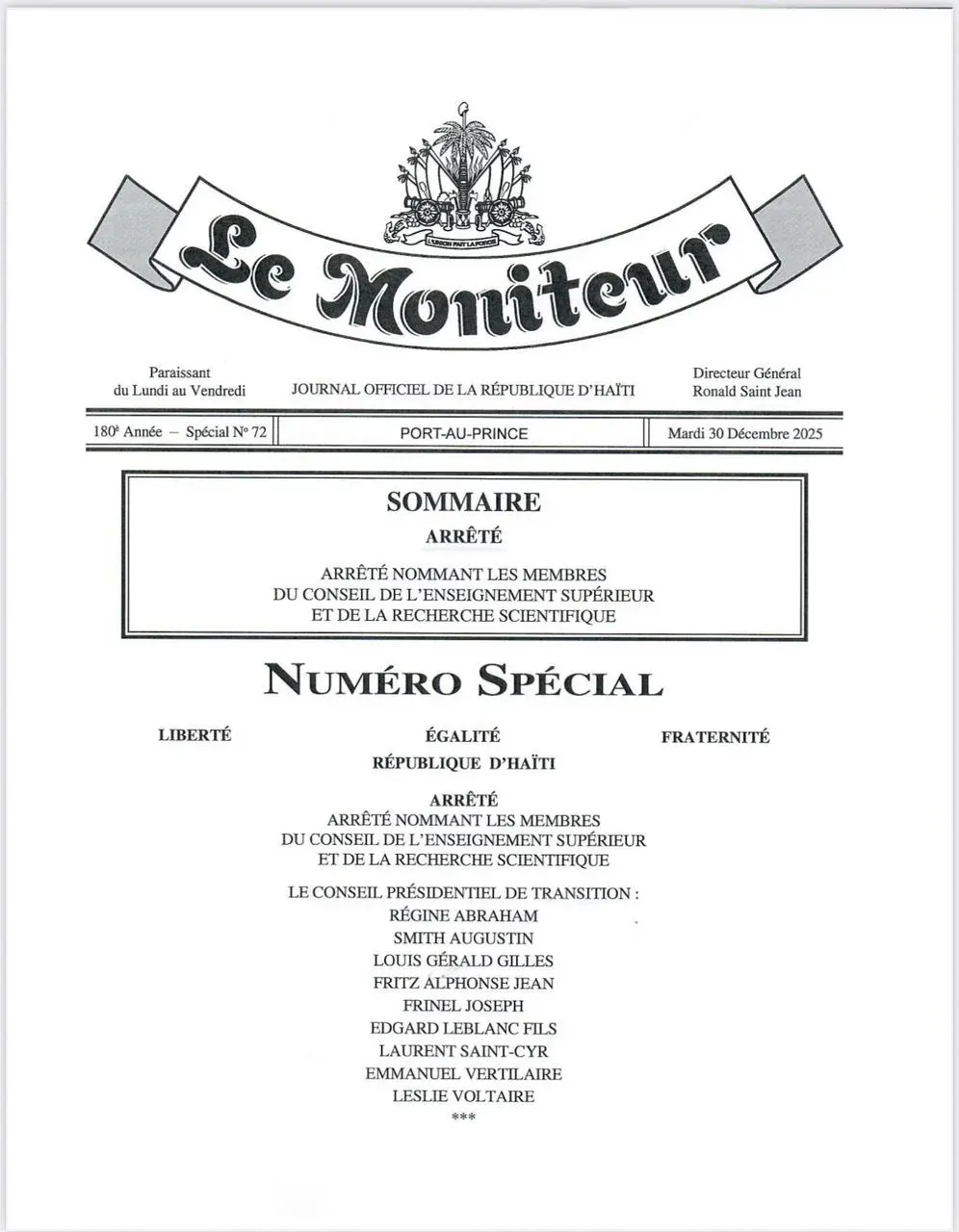Table des matières
Cet article examine le génie interscolaire dans la région de Jérémie, en Haïti, en tant que pratique de loisir organisée par et pour des écoliers. L’analyse s’appuie sur deux expériences de génie interscolaire. Le JUJ-Génie, organisé depuis 2010 par l’Association des Jeunes Universitaires pour le Développement de la Grand’Anse (AJUDG), s’adresse aux établissements scolaires de la ville de Jérémie. S’inspirant de cette initiative pionnière, la Star-Génie a été créée par Young-Stars pour les écoles des communes de Bombon et des Abricots. Les données présentées émanent de mon expérience personnelle en tant que joueur et organisateur. L’analyse révèle que le génie interscolaire pallie les carences en équipements de loisir, qu’il articule les trois fonctions du loisir (détente, divertissement et développement cognitif) et qu’il atténue les contraintes du modèle d’apprentissage traditionnel confiné aux quatre murs de la salle de classe. Néanmoins, le génie interscolaire entretient un rapport ambigu avec le loisir.
Introduction
Le week-end constitue désormais une réalité tangible pour la jeunesse haïtienne. Les indicateurs de cette temporalité spécifique se manifestent avec une visibilité croissante. Il suffit d’observer, notamment sur les réseaux sociaux et particulièrement dans les statuts WhatsApp, l’euphorie collective qui s’empare des jeunes dès le jeudi. L’expression « Jou jedi ! » revêt, pour certains, une connotation liée à un culte de la sexualité. Selon le discours ambiant, le jeudi serait propice aux rapports intimes. Par extension, cette journée s’inscrit dans ce que Pais (1993, p. 293) qualifie de code de « l’éthique du divertissement », signalant ainsi le début anticipé de la fin de semaine. Le jeudi s’intègre de facto dans la temporalité du week-end, d’où l’expression couramment utilisée de « tèt wikenn » sur les réseaux sociaux numériques et au sein des communautés juvéniles haïtiennes.
Ce phénomène culturel autour du jeudi traduit l’émergence d’un « long week-end », expression vernaculaire rendue par « yon wikenn byen long » en créole haïtien. Cette formulation témoigne d’une redéfinition de la délimitation traditionnelle du week-end, historiquement circonscrit aux journées du samedi et du dimanche. Le long week-end s’étend désormais du jeudi au dimanche, période que je conçois, dans le cadre de cette étude, comme un segment temporel principalement consacré aux activités de plaisir et de divertissement. Le week-end devient ainsi synonyme d’activités et de pratiques de loisir, ce qui oriente naturellement mon intérêt vers l’analyse de ces dernières dans la société haïtienne contemporaine. Il convient néanmoins de reconnaître que cette conception de la fin de semaine présente un caractère homogénéisant et unificateur, occultant potentiellement d’autres significations : pour certains segments de la population, ces journées demeurent consacrées à la prière, à la spiritualité ou aux activités marchandes et de débrouille.
Dans cette perspective, il apparaît pertinent d’examiner les autres activités de loisir pratiquées par la catégorie juvénile (Donnat & Lévy, 2007), particulièrement par les écoliers durant cette période hebdomadaire. Cette réflexion soulève des interrogations essentielles : quel usage les écoliers de la région de Jérémie font-ils de leur week-end, dans un contexte marqué par une sexualisation croissante de cette temporalité ? Comment investissent-ils leur temps libre face à cette tendance culturelle ? Ces questionnements me conduisent à analyser simultanément l’usage du temps libre des écoliers et à examiner en profondeur une activité de loisir spécifique : le génie interscolaire.

Cette étude se concentre sur l’analyse d’une activité de divertissement singulière dans la région de Jérémie : le génie interscolaire[1], que je conceptualise comme une pratique de loisir scolaire. Cette dernière se définit comme une activité articulant divertissement et apprentissage dans un cadre structuré. Cette approche permet de prendre distance avec la dichotomie traditionnelle opposant école et loisir en général, instruction et divertissement en particulier[2]. Le génie interscolaire est ici appréhendé comme une pratique de loisir organisée par et pour des écoliers, révélant ainsi l’un des usages que les écoliers de la région de Jérémie[3] font de leur week-end. En ce sens, le génie interscolaire constitue une manifestation du « week-end scolaire » (Dumazedier, 1985), représentant l’une des activités privilégiées par les écoliers pour pallier les carences liées à l’apprentissage traditionnel tout en relativisant la sexualisation du week-end caractéristique de la jeunesse haïtienne.
Mon analyse s’appuie sur deux expériences concrètes de génie interscolaire. La première, le JUJ-Génie, est organisée depuis 2010 par l’Association des Jeunes Universitaires pour le Développement de la Grand’Anse (AJUDG) et s’adresse aux établissements scolaires de la ville de Jérémie. S’inspirant de cette initiative pionnière, la Star-Génie a été développée par Young-Stars pour les écoles des communes de Bombon et des Abricots. L’observation de ces expériences révèle que le génie interscolaire compense l’insuffisance d’équipements de loisir dans les établissements scolaires, qu’il articule harmonieusement les trois fonctions du loisir (détente, divertissement et développement cognitif) et qu’il atténue les contraintes du modèle d’apprentissage traditionnel confiné aux quatre murs de la salle de classe. Néanmoins, la relation qu’entretient cette pratique avec le modèle éducatif conventionnel demeure ambiguë. Le génie interscolaire s’affirme ainsi comme une dimension constitutive de la conception du « week-end scolaire ».
1. Du loisir au week-end scolaire : quelques précisions conceptuelles
Pour appréhender l’usage du temps libre des écoliers et analyser le génie interscolaire dans la région de Jérémie, cette étude s’inscrit dans une approche sociologique du loisir et du temps libre (Pronovost et al., 1993). Cette approche disciplinaire vise à examiner les manifestations temporelles situées en dehors du temps de travail (temps d’étude dans le cas des écoliers) ou de l’occupation principale. Les théoriciens du loisir mobilisent diverses notions pour circonscrire leur objet : temps libre, temps du non-travail ou temps libéré (Beaucejour, 2021). Le sociologue Gilles Pronovost souligne que « l’une des approches les plus classiques qu’ait empruntées la sociologie du loisir pour traiter la spécificité de son champ d’études l’a été par la notion de “temps”, mais surtout de “temps libre” [...] » (Pronovost, 2014, p. 1). Il précise par ailleurs qu’« une sociologie du loisir s’est appuyée sur la sociologie des temps sociaux et que ses fondements empiriques étant tournés précisément dans les études d’emploi du temps » (Pronovost, 2014, p. 2).
Bien que les qualificatifs de temps non travail, temps libre ou temps libéré ne renvoient pas au même horizon théorique, ils convergent dès lors que l’on considère que ces temporalités s’assimilent aux activités de loisir. Dans cette perspective, le loisir se conçoit comme un ensemble d’activités pratiquées durant le temps libre, en dehors des obligations professionnelles dominantes. C’est précisément cette approche qui éclaire ma compréhension du génie interscolaire en tant que pratique de loisir[4]. Plus spécifiquement, mes analyses s’appuient sur la théorie des trois « D » développée par le sociologue français Joffre Dumazedier. Selon cet auteur, « le loisir est un ensemble d’occupations auxquelles l’individu peut s’adonner de plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice après s’être dégagé de ses obligations professionnelles, familiales et sociales » (Dumazedier, 1962, p. 29).
Le loisir remplit trois fonctions essentielles. La première, le délassement, vise à réduire la fatigue physique et mentale des individus en jouant un rôle récupérateur. Les individus s’engagent fréquemment dans des activités de loisir pour se relaxer et restaurer leurs capacités. La deuxième fonction, le divertissement, s’oppose à l’ennui en permettant à l’individu de se détendre et de s’affranchir temporairement des problèmes et tourments de la vie quotidienne. Ces moyens de divertissement peuvent revêtir des formes fictives ou réelles. Enfin, le développement de la personnalité constitue la troisième fonction du loisir. Cette dimension revêt une importance capitale pour l’apprentissage et l’épanouissement culturel, favorisant le développement des capacités intellectuelles, l’acquisition de nouvelles connaissances et l’adoption de modalités d’apprentissage inédites. Cette fonction de développement personnel encourage ainsi une participation active dans les activités de loisir.
Dans le prolongement de cette approche théorique, mes analyses mobilisent également le concept de « week-end scolaire » proposé par Joffre Dumazedier (1985). Cette notion émerge dans le contexte de la libéralisation du samedi par le ministère de l’Éducation nationale en France. Selon l’auteur, le week-end, les soirées et les vacances constituent les temporalités libres les plus étendues à partir de 18 ans. Le week-end s’affirme ainsi comme un temps social générateur de nouvelles valeurs et transformateurs des mœurs pour toutes les catégories d’âge. Dans le cadre de cet article, le génie interscolaire désigne un ensemble de pratiques ludiques et de loisir adoptées par les écoliers durant les journées de fin de semaine.
2. Une approche méthodologique expérientielle
Les données de cette recherche émanent de mes expériences personnelles et de mon engagement dans les activités de génie interscolaire. J’ai participé en tant qu’écolier, puis ai assumé la fonction de coordonnateur de l’Association des jeunes universitaires pour le développement de la Grand’Anse (AJUDG)[5] de 2018 à 2020. Ce parcours m’a placé en contact direct avec les activités de génie interscolaire dans la ville de Jérémie, me conférant une double perspective : celle du bénéficiaire et celle de l’organisateur. Cette expérience constitue ainsi le fondement de la démarche méthodologique adoptée dans ce travail.
Pour systématiser cette expérience, j’ai mobilisé la méthode de la participation observante (Soulé, 2007). Cette technique de recherche permet de rendre intelligibles et compréhensibles des expériences et des pratiques de la vie quotidienne, tout en permettant au chercheur de s’immerger dans son terrain d’étude. Elle constitue un renouvellement de l’observation participante, méthode privilégiée de l’ethnographie. Contrairement à cette dernière, la participation observante inverse la séquence méthodologique : la participation précède l’observation et s’effectue durant une phase de pré-enquête. Cette approche m’a permis de prendre conscience de manière réflexive de mon expérience au sein des activités de génie interscolaire.
Pour compléter ces observations préalables, j’ai exploité un corpus documentaire relatif aux activités de génie interscolaire dans la région de Jérémie. Ce corpus comprend des articles de presse, des photographies, des enregistrements vidéo ainsi que les pages Facebook des structures organisatrices. Ces documents permettent de retracer l’évolution des activités de génie interscolaire et, plus particulièrement, d’orienter l’analyse sur la perception et les expériences des écoliers avant, pendant et après les activités.
La population étudiée dans cette recherche correspond à la catégorie des écoliers participant aux activités de génie interscolaire. Cette catégorie englobe les élèves impliqués dans l’activité, qu’ils soient joueurs ou supporteurs de leur établissement scolaire. Les élèves constituent ainsi le cœur de cette étude, dans la mesure où l’analyse porte spécifiquement sur l’usage qu’ils font de leur temps libre.
3. Le génie interscolaire et son émergence dans la région de Jérémie
Cette section retrace l’émergence des activités de loisir de génie interscolaire dans la région de Jérémie à travers l’analyse de deux expériences organisationnelles distinctes. Cette approche historico-contextuelle permet de saisir la production de ce loisir scolaire dans ses dimensions spatiales et temporelles. Les deux expériences étudiées s’inscrivent dans des contextes d’apprentissage différenciés : l’une se déploie en milieu urbain, dans la ville de Jérémie, tandis que l’autre s’ancre dans un espace rural, la section communale d’Anse-du-Clerc.
3.1. JUJ-Génie : une expérience pionnière
Depuis 2010, les écoliers de la ville de Jérémie participent à des activités de génie interscolaire. Cette initiative émane d’un groupe de jeunes étudiants grandanslais regroupés au sein de l’Association des Jeunes Universitaires pour le Développement de la Grand’Anse (AJUDG). À l’époque de la création, ces étudiants poursuivaient leurs études supérieures dans les centres universitaires de Port-au-Prince. L’organisation place l’instruction et l’orientation professionnelle au cœur de ses priorités, ce qui a conduit ses membres à lancer leur première et principale activité, communément désignée sous l’appellation « JUJ-Génie ».
Le JUJ-Génie constitue une compétition interscolaire organisée dans la ville de Jérémie depuis 2010. Ce concours de connaissances générales vise à permettre aux écoliers et autres participants d’acquérir une maîtrise des grands événements de l’histoire de l’humanité, des notions fondamentales en biologie, chimie, mathématiques et physique, ainsi que des thématiques qui ne figurent pas nécessairement dans le programme officiel du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP). L’AJUDG a organisé la neuvième et dernière édition de cette compétition au cours du trimestre s’étendant de mars à mai 2022 (Calixte, 2022). Depuis sa création, le JUJ-Génie a connu plusieurs transformations structurelles. Initialement conçu pour cibler l’ensemble des classes du secondaire, le format de la compétition a évolué au fil des éditions.
De la première à la sixième édition, le comité d’organisation structurait la compétition autour des classes traditionnelles soumises aux examens d’État, à savoir les classes de neuvième année et les classes terminales I et II. Chaque établissement scolaire était alors représenté par trois équipes correspondant à ces trois niveaux. Une transformation majeure intervient lors de la septième édition en 2016 : le comité organisateur décide de fusionner les trois équipes en une seule par établissement. Cette équipe unique devait désormais intégrer des représentants de toutes les classes du secondaire, de la troisième (nouveau secondaire I) à la terminale II (nouveau secondaire IV). Cette évolution témoigne des ajustements constants opérés tant dans le format que dans l’organisation du JUJ-Génie.
Ces transformations structurelles résultent directement des difficultés récurrentes rencontrées par les comités d’organisation dans la mise en œuvre de cette activité ludique et éducative destinée aux écoliers jérémiens. Les contraintes sont multiples : insuffisance de moyens matériels et financiers, réticence de certains directeurs d’établissements scolaires qui craignent que la participation de leur école à ces compétitions n’entraîne un déclassement dans la perception publique. Cette appréhension révèle l’un des enjeux majeurs des génies interscolaires. Par ailleurs, les organisateurs font face à des difficultés récurrentes pour obtenir un espace adéquat à un coût accessible. Cette contrainte explique la rotation des lieux d’accueil entre l’Alliance française de Jérémie, le centre Karl Édouard Peters et le centre Mariste. Le Foyer culturel, qui constituait initialement l’espace privilégié de ces événements, est devenu progressivement inaccessible en raison de l’augmentation des coûts de location. Enfin, malgré la reconnaissance officielle de la direction départementale de l’éducation, le JUJ-Génie ne bénéficie d’aucun soutien institutionnel des autorités départementales. Sa réalisation repose essentiellement sur l’engagement des membres de l’organisation, le soutien de particuliers et l’appui ponctuel de quelques entreprises du secteur privé de Jérémie.
3.2. Star-Génie ou la diffusion du JUJ-Génie
La deuxième expérience analysée concerne le génie interscolaire d’Anse-du-Clerc, organisé par l’association Young-Stars[6]. Cette organisation regroupe des jeunes originaires et résidents de la section communale d’Anse-du-Clerc. La Star-Génie représente une extension territoriale du modèle JUJ-Génie. Cette initiative résulte de la volonté d’un membre de l’AJUDG, également membre fondateur de Young-Stars, d’implanter l’expérience du génie interscolaire dans sa localité d’origine, la section communale d’Anse-du-Clerc, située dans la commune des Abricots. En collaboration avec les autres membres de son organisation, il a structuré un génie à la fois interscolaire et intercommunal. La première édition s’est tenue en 2021, suivie d’une deuxième édition qui s’est achevée le 22 mai 2022. Le format adopté par la Star-Génie s’inspire du modèle initial du JUJ-Génie, structurant la compétition autour des deux niveaux scolaires soumis aux examens officiels du MENFP : les classes de neuvième année et de nouveau secondaire IV (anciennement classe terminale II). Cette configuration permet aux écoliers participants de mieux se préparer aux examens officiels.

La Star-Génie s’organise dans la section communale d’Anse-du-Clerc, siège de l’association Young-Stars. Cette zone occupe une position géographique centrale entre les communes de Bombon et des Abricots. Contrairement au JUJ-Génie, circonscrit aux établissements scolaires du centre urbain de Jérémie, la Star-Génie mobilise des écoles issues de plusieurs communes rurales. Cette dimension intercommunale favorise l’établissement de liens entre écoliers et habitants de communes souvent isolées les unes des autres. Face aux difficultés structurelles des écoles rurales et aux inégalités persistantes entre établissements ruraux et urbains, la Star-Génie intègre les écoliers, qu’ils soient participants ou supporteurs, dans une dynamique compétitive stimulante. Cette zone souffre particulièrement d’une pénurie de professeurs qualifiés et compétents. L’objectif du génie est donc double : faciliter la préparation des écoliers aux examens officiels et renforcer leur préparation aux concours d’admission dans les universités reconnues du pays. Ces expériences de génie interscolaire contribuent ainsi à l’instruction des écoliers tout en développant leurs capacités autodidactes. Cette double fonction justifie la nécessité de promouvoir ces initiatives dans l’ensemble de la région de Jérémie et, plus largement, à l’échelle nationale.
4. Le génie interscolaire et ses dimensions
Le génie interscolaire est appréhendé dans cette étude comme une pratique de loisir scolaire. Il désigne une activité conjuguant divertissement, détente et développement personnel, conçue pour et avec un public écolier qui se mobilise par centaines, non seulement pour soutenir leur établissement scolaire, mais également pour se détendre et s’instruire. Cette pratique constitue l’une des occupations privilégiées des apprenants durant les jours de fin de semaine. Cette activité de loisir vise à contourner certaines difficultés inhérentes au système éducatif haïtien et aux conditions matérielles des établissements scolaires. Elle entretient néanmoins un rapport ambigu avec le modèle d’apprentissage hégémonique.
4.1. Le génie interscolaire pallie le problème d’équipement de loisir dans les écoles
Cette section propose un état des lieux des équipements de loisir dans les établissements scolaires, en se concentrant sur le cas emblématique du Lycée Nord Alexis de Jérémie. Le choix de cet établissement s’explique par sa situation paradoxale : bien qu’il dispose d’espaces théoriquement destinés aux activités de divertissement et qu’il figure parmi les plus vastes établissements scolaires de la ville, sa configuration révèle les tensions entre école et loisir. Bien qu’une analyse exhaustive de tous les établissements participant régulièrement au génie interscolaire serait pertinente, cette étude se limite, pour des raisons de faisabilité, au cas du Lycée Nord Alexis.
Le lycée Nord Alexis possède théoriquement un ensemble diversifié d’espaces de loisir et de jeu. Dans une certaine mesure, il pourrait être considéré comme relativement équipé en dispositifs ludiques. L’établissement dispose d’espaces dédiés aux activités sportives et culturelles : un mini-terrain de jeu polyvalent utilisable pour le football, le volleyball, le basketball et potentiellement le tennis ; une salle aménagée pour bibliothèque ; une salle informatique ; ainsi qu’un auditorium pouvant servir de salle de spectacle, de conférence, d’exposition ou de projection cinématographique. Cette infrastructure suggérerait un environnement scolaire dynamique en matière de loisirs. Paradoxalement, si les espaces existent, ces pratiques et activités demeurent largement absentes.
Ces espaces ludiques et de loisir restent en effet largement sous-exploités, voire dysfonctionnels. Le terrain de jeu, malgré son importance potentielle pour les lycéens, souffre d’un manque criant d’équipements : absence de traçage au sol, de filets pour le volleyball et le tennis, de paniers pour le basketball. Les rares championnats de football organisés le sont à l’initiative exclusive des écoliers, sans encadrement institutionnel. La bibliothèque, malgré son existence physique, demeure non fonctionnelle au moment de nos observations en 2022 et 2024 : les ouvrages, obsolètes et inadaptés aux besoins de formation de la communauté lycéenne, sont recouverts de poussière, témoignant d’une fréquentation quasi nulle. L’auditorium n’accueille qu’une seule activité annuelle : la fête des philosophes commémorée le 28 janvier. Cette sous-utilisation chronique des espaces disponibles explique en partie l’émergence de pratiques de loisir alternatives, notamment le jeu « relié cinq » (« jwèt mòpyon »), devenu dominant dans la plupart des lycées. Cette situation illustre que la relation entre espace et pratique de loisir n’est pas automatique : la disponibilité spatiale n’engendre pas mécaniquement l’activité de loisir (Beaucejour, 2020).
Dans ce contexte, le génie interscolaire apparaît comme une réponse adaptée aux carences d’équipements de loisir dans les établissements scolaires de la région de Jérémie. La situation du lycée Nord Alexis, loin d’être exceptionnelle, reflète une réalité largement partagée. Rares sont les écoles disposant d’espaces de divertissement et d’apprentissage extérieurs aux salles de classe traditionnelles. La majorité des établissements scolaires du pays, et de la région de Jérémie en particulier, sont dépourvus d’espaces de loisir destinés aux élèves. Terrains de jeu, bibliothèques et salles informatiques demeurent quasi inexistants . Les rares établissements dotés de tels équipements les maintiennent dans un état dysfonctionnel et impraticable, à l’image du lycée Nord Alexis. Cette situation favorise l’émergence et le développement de pratiques de divertissement alternatives. Par conséquent, la carence structurelle en équipements de loisir dans les écoles constitue paradoxalement une condition favorable au développement des activités de génie interscolaire.
4.2. Une articulation des trois fonctions du loisir dans le génie interscolaire
Cette section analyse la manière dont les trois fonctions du loisir s’articulent dans les activités de génie interscolaire, en explicitant comment ces dernières incarnent simultanément le divertissement, la détente et le développement cognitif des participants, particulièrement des écoliers. Il est rare d’identifier dans la société haïtienne contemporaine une activité de loisir qui intègre harmonieusement ces trois dimensions. Cette analyse se fonde sur une interprétation de la théorie du loisir développée par le sociologue Joffre Dumazedier (1962, 1977, 1985) – que je désigne comme la théorie des trois « D » – à travers le prisme du concept de week-end scolaire.
Premièrement, le génie interscolaire remplit une fonction de délassement pour les participants. Cette dimension répond au poids des contraintes supportées par les écoliers durant les journées de classe. L’enseignement constitue une expérience exigeante en termes d’efforts et d’énergie. L’activité de loisir interscolaire permet aux participants de s’affranchir temporairement de ces contraintes pédagogiques, en créant une ambiance propice à la relaxation et à la régénération physique et mentale. Les animations musicales et l’atmosphère festive qui caractérisent les rencontres renforcent cette dimension récréative. Ainsi, ce loisir scolaire contribue à atténuer la fatigue physique et cognitive accumulée durant la semaine de cours.
Deuxièmement, les activités de génie interscolaire constituent un vecteur essentiel de divertissement pour les écoliers. Ces activités représentent un espace de récréation situé en marge des salles de cours et, plus largement, du cadre scolaire traditionnel. Le génie interscolaire s’affirme comme une expression du temps non scolaire, un temps social nécessaire au développement équilibré des écoliers. À l’instar des jours de congé, il constitue une temporalité rarement investie par des activités strictement académiques. Le génie interscolaire permet aux écoliers de jouir pleinement de ce temps libre, facilitant également leur socialisation en dehors du cadre scolaire. Cette activité de loisir remplit ainsi une fonction de détente essentielle, aidant l’écolier à combattre l’ennui et servant d’espace d’évasion où l’apprentissage s’effectue sous des modalités moins contraignantes. Cette configuration illustre parfaitement la fonction de divertissement inhérente aux activités de génie interscolaire.
Troisièmement, le génie interscolaire constitue un espace privilégié de développement cognitif, stimulant les capacités intellectuelles des participants. Cette dimension se manifeste à plusieurs niveaux. D’abord, il permet aux écoliers d’acquérir de nouvelles connaissances à travers leurs recherches personnelles et les échanges avec leurs pairs. Les questions posées durant les compétitions orientent également leur curiosité vers l’approfondissement de diverses matières. Ensuite, le génie interscolaire fonctionne comme un espace de rencontre et de socialisation, permettant aux élèves de tisser de nouveaux liens amicaux et de renforcer les relations existantes. Enfin, la préparation et la participation aux matchs de génie favorisent une ouverture sur le monde, les écoliers devant se tenir informés de l’actualité nationale et mondiale. Ces différents éléments concourent au développement des capacités intellectuelles des élèves, facteur déterminant dans la réussite de leur parcours scolaire.
Le génie interscolaire réussit ainsi à concilier harmonieusement ces trois fonctions du loisir. Les écoliers se divertissent et se délassent tout en enrichissant leurs connaissances, établissant un lien fécond entre plaisir et apprentissage, deux dimensions trop souvent opposées dans les représentations communes. Cette activité illustre de manière exemplaire la notion de loisir scolaire, en articulant de façon équilibrée les aspects ludiques et pédagogiques, démontrant ainsi que divertissement et éducation peuvent non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement.
5. Le génie interscolaire ou l’ambiguïté d’un modèle d’apprentissage alternatif
Cette section examine le rapport ambigu qu’entretiennent les activités de génie interscolaire avec le modèle d’apprentissage hégémonique dans les écoles haïtiennes. Cette ambiguïté se manifeste dans le paradoxe suivant : bien que cette activité de loisir offre aux écoliers un espace d’apprentissage extérieur aux salles de cours traditionnelles, elle ne parvient pas à s’affranchir véritablement du modèle pédagogique traditionnel dominant. Ce modèle se caractérise par un mode d’apprentissage circonscrit aux salles de classe et strictement encadré par le curriculum du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP). Ce mode d’instruction s’apparente à ce que Louis-Juste (2004) qualifie d’« éducation bancaire », privilégiant la mémorisation au détriment de la compréhension et s’orientant vers un savoir extraverti. Il minorise également la langue maternelle des Haïtiens. C’est la raison pour laquelle, la littérature sur l’école en Haïti parle de la crise de l’éducation (Govain, 2023).
À première vue, le génie interscolaire semble favoriser un dépassement de ce modèle d’apprentissage traditionnel. Cette compétition scolaire propose une alternative pédagogique en cultivant l’esprit d’ouverture des écoliers participants. Elle offre aux apprenants l’opportunité d’assimiler plus efficacement le programme scolaire tout en leur permettant d’approfondir les notions abordées en classe. Elle initie les élèves à la recherche documentaire dans les bibliothèques et, surtout, à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), favorisant ainsi une appropriation différente de ces outils numériques par les écoliers. Cette approche encourage l’autonomie et stimule la curiosité intellectuelle des participants. Le génie interscolaire se présente ainsi comme un espace d’apprentissage alternatif, situé hors des murs de la classe traditionnelle.
Cependant, le génie interscolaire ne remet pas fondamentalement en question le mode d’apprentissage traditionnel dominant. Plusieurs éléments attestent de cette limite structurelle. Premièrement, l’activité demeure circonscrite aux matières traditionnellement enseignées dans les établissements scolaires. La maîtrise du contenu de ces disciplines repose essentiellement sur la mémorisation, orientation renforcée par la formulation même des questions. La connaissance des réponses aux questions posées n’implique pas nécessairement une compréhension profonde de la matière. Bien que la banque de questions se renouvelle théoriquement à chaque rencontre, il convient de souligner que certaines questions récurrentes – phénomène désigné localement sous le terme « tchala » – favorisent une approche mémorielle plutôt que réflexive. Par conséquent, le génie interscolaire ne développe pas nécessairement les compétences pratiques permettant de mobiliser les connaissances pour résoudre des problèmes concrets de la vie quotidienne.
Deuxièmement, cette activité de loisir ne stimule pas suffisamment l’intérêt des écoliers pour l’approfondissement de leurs connaissances sur Haïti, particulièrement sur la région de Jérémie. L’un des objectifs spécifiques de ces activités étant d’aider les élèves à préparer les examens officiels, elles reproduisent, à l’instar du curriculum scolaire, une préférence marquée pour les savoirs exogènes au détriment des connaissances locales. À l’exception des questions relevant des rubriques d’histoire nationale, de connaissances générales ou de « grands hommes haïtiens », toutes les autres catégories portent sur des savoirs issus d’autres sociétés, ces dernières bénéficiant d’ailleurs d’une pondération supérieure. Cette configuration perpétue l’extraversion des savoirs, trait caractéristique du système éducatif haïtien.

Enfin, le génie interscolaire, malgré son importance indéniable pour les écoliers, participe paradoxalement à la reproduction des inégalités scolaires. Cette activité de loisir scolaire reste silencieuse face à cette problématique structurelle du système éducatif haïtien. Les établissements scolaires ne disposent pas des mêmes ressources ni n’investissent équitablement dans la formation de leurs élèves. Les écoles sont généralement représentées par leurs élèves les mieux classés, sélectionnés a priori parmi les plus « doués » et les plus « performants ». Les écoliers « moins performants » sont relégués au rôle de supporteurs, même si la dynamique et l’ambiance des rencontres peuvent occasionnellement les inciter à s’engager dans l’acquisition de connaissances. Ce clivage au sein de la population écolière cristallise deux figures antagonistes : l’« élève-vedette » et l’« élève-fanatique ». Les critères de sélection des joueurs maintiennent ainsi la hiérarchie scolaire existante et favorisent les élèves déjà avantagés et favorisés.
Cette reproduction des inégalités se manifeste également dans les résultats des compétitions, systématiquement remportées par les établissements scolaires réputés les plus performants – aspect qui mériterait une analyse plus approfondie. Cette perpétuation des inégalités scolaires, bien que non souhaitée par les organisateurs du génie interscolaire, les conduit à développer des stratégies compensatoires. L’AJUDG, par exemple, organise des séminaires de mise à niveau ouverts à tous les élèves, tentant ainsi d’atténuer les disparités et inégalités structurelles du système éducatif haïtien.
Conclusion
Cette étude s’est attachée à analyser l’un des usages du week-end par les écoliers de la Grand’Anse à travers l’examen des activités de loisir du génie interscolaire. L’analyse comparative de deux expériences distinctes – le JUJ-Génie et la Star-Génie dans la région de Jérémie – a permis de dégager plusieurs constats significatifs. Premièrement, cette activité de loisir scolaire pallie efficacement les carences en équipements de loisir qui caractérisent la majorité des établissements scolaires de la région. Deuxièmement, elle réussit à articuler harmonieusement les trois fonctions du loisir théorisées par Dumazedier : délassement, divertissement et développement cognitif. Troisièmement, elle entretient un rapport paradoxal avec le modèle d’apprentissage traditionnel dominant, ne parvenant pas à s’en distancier véritablement malgré ses ambitions alternatives.
Cette recherche présente néanmoins certaines limites méthodologiques qu’il convient de reconnaître. Les techniques de recherche mobilisées – participation observante et analyse documentaire – présentent des contraintes inhérentes. Malgré ma sensibilité particulière au point de vue des écoliers, leur discours direct n’a pu être intégré dans cette analyse, lacune résultant de l’absence d’entretiens formels dans le dispositif méthodologique. Par ailleurs, la participation observante, si elle favorise une immersion profonde dans les activités du génie interscolaire, peut légitimement soulever des interrogations quant à l’objectivité de la description des faits rapportés. En outre, cette étude a minimisé la dimension du stress, sentiment pourtant omniprésent chez les écoliers participants, particulièrement chez les joueurs. Ce stress constitue un élément inhérent aux activités de génie interscolaire qui mériterait une analyse approfondie. Comme toute recherche scientifique, les résultats présentés ici demeurent provisoires et appellent des investigations complémentaires et approfondies.
Il convient de souligner que le week-end scolaire dans la région de Jérémie ne se limite pas au génie interscolaire, mais englobe diverses expressions : championnats sportifs, compétition de débat, activités de danse latine, pratiques religieuses, programmes festifs. Souvent, ces activités sont le résultat d’initiatives des organisations de la société civile. Par exemple, je peux mentionner les initiatives de GHATES, de CICED, de KOREM et tant d’autres. Cette diversité soulève des interrogations stimulantes pour de futures recherches. Peut-on parler d’une véritable diversification des pratiques de loisir scolaire dans la région de Jérémie ? Au-delà du génie interscolaire, comment les écoliers investissent-ils leur temps libre principal ? Dans quelle mesure ce temps libre et libéré reproduit-il ou s’affranchit-il des rapports de pouvoir colonial, de classe ou de sexe ? Quelles catégories d’écoliers manifestent le plus d’intérêt pour la participation au génie interscolaire ? L’expérience de cette pratique de loisir est-elle vécue de manière uniforme par tous les élèves ? Quelle perception en ont les parents et les enseignants ? Comment les génies interscolaires pourraient-ils servir un authentique espace d’apprentissage alternatif et émancipateur ? Ces questionnements ouvrent des perspectives de recherche prometteuses pour approfondir la compréhension des pratiques de loisir scolaire en Haïti.
Bibliographie
Anglade, G. (1982). Atlas critique d’Haïti. ERCE & CRC. https://classiques.uqac.ca/contemporains/anglade_georges/atlas_critique_haiti/atlas_critique_haiti.html
Beaucejour, P. (2020, 22 juillet). La ville de Jérémie : de la « cité des poètes » à la « cité des Dexter ». Vers une redéfinition des pratiques de loisirs. JCOM Haiti, https://jcomhaiti.com/la-ville-de-jeremie-de-la-cite-des-poetes-a-la-cite-des-dexter-vers-une-redefinition-des-pratiques-de-loisirs/
Beaucejour, P. (2021). Production de loisir collectif dans le contexte des mutations urbaines de Port-au-Prince : Un cheminement décolonial des programmes, Car Wash à Bas Peu-de-Chose [Mémoire de licence non publié]. Faculté des Sciences humaines, Université d’État d’Haïti.
Calixce, J. (2022, 26 mai). JUJ-Génie : chronique d’une activité phare dans la Grand’Anse. Le National. https://lenational.org/post_article.php?soc=202
Donnat, O., & Lévy, F. (2007). Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques. Culture prospective, (3), 1-31. https://doi.org/10.3917/culp.073.0001
Dumazedier, J. (1962). Vers une civilisation des loisirs. Éditions du Seuil.
Dumazedier, J. (1977, 5 décembre). Une politique en miettes. Le Monde.
Dumazedier, J. (1985, 9 avril). Enfin le week-end scolaire ? Le Monde.
Louis-Juste, J. (2004, 6 août). Haïti : Jeunesse, Université et Société. AlterPresse. https://www.alterpresse.org/spip.php?article1554
Pais, J. M. (1993). L’ « éthique du divertissement » dans les cultures juvéniles. Dans G. Pronovost, C. Attias-Donfut & N. Samuel (dir.), Temps libre et modernité : Mélanges en l’honneur de Joffre Dumazedier (pp. 293-303). Presses de l’Université du Québec ; L’Harmattan.
Pronovost, G. (2014). Sociologie du loisir, sociologie du temps. Temporalités. http://journals.openedition.org/temporalites/2863
Pronovost, G., Attias-Donfut, C., & Samuel, N. (dir.). (1993). Temps libre et modernité : Mélanges en l’honneur de Joffre Dumazedier. Presses de l’Université du Québec ; L’Harmattan.
Soulé, B. (2007). Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. Recherches qualitatives, 27(1), 127-140.
Notes
[1] Le génie interscolaire constitue une activité largement répandue dans le milieu social haïtien, organisée dans plusieurs villes du pays. La présente étude se concentre spécifiquement sur la région de Jérémie.
[2] Concernant l'imaginaire qui sépare l'école du loisir dans le contexte haïtien, il suffit de constater, sur les réseaux sociaux numériques (Facebook, Instagram, TikTok et WhatsApp), les griefs contre les écoliers qui dansent et fêtent la fin de l'année scolaire. Je n'ai pas l'intention d'aborder cet imaginaire du loisir scolaire dans le cadre de cette recherche. Une analyse de cette situation pourrait faire l'objet d'une recherche à part entière.
[3] Dans ce texte, « Jérémie » ne se limite pas au centre urbain, mais désigne la région de Jérémie dans son ensemble. Cette conception s’inspire de l’approche régionale développée par Georges Anglade dans Atlas critique (1982). La région de Jérémie correspond ainsi au département de la Grand’Anse, englobant les communes et les zones environnantes. Lorsque le terme « Jérémie » fait référence spécifiquement à la ville, cette précision est explicitement mentionnée.
[4] Il convient de noter que j’ai esquissé une critique de cette conception définissant le loisir par rapport au temps dans mon mémoire de licence, où je démontre que cette approche reste empreinte d’eurocentrisme (Beaucejour, 2021).
[5] Consulté la page Facebook de l’association via ce lien : https://www.facebook.com/Associationjudg
[6] Consulté la page Facebook de l’association via ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069487890973
Remerciements
Je tiens à remercier Magalie Civil pour la relecture de cet article.
À propos de l’auteur