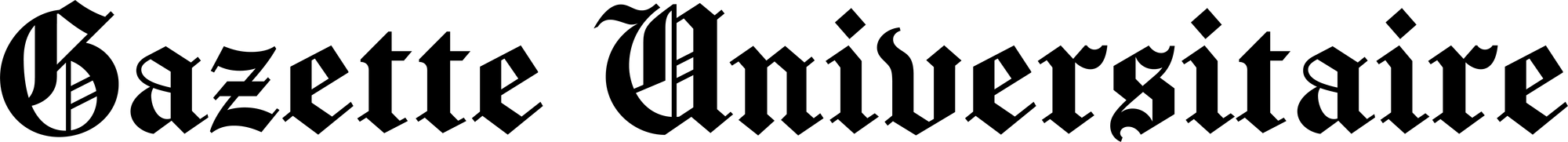Table des matières
La nuit où l'État a rendu l'âme
Imaginez une scène surréaliste. Nous sommes en juillet 2021, dans la résidence criblée de balles du président Jovenel Moïse. Alors que le corps du chef de l'État refroidit à même le sol, deux forces se mettent en mouvement. D'un côté, une police haïtienne sous-équipée, paralysée, qui ne sait même pas par où commencer l'enquête. De l'autre, le FBI américain atterrissant à Port-au-Prince moins de 48 heures plus tard, prenant de facto le contrôle des investigations, des preuves, de la narration officielle. Le message était limpide : même la mort du président ne relevait plus de la souveraineté nationale, mais d'une compétence externalisable. Cette nuit-là, l'État haïtien n'a pas été attaqué ; il a été constaté absent.
Depuis le séisme de 2010, Haïti n'est plus gouverné. Il est géré. Géré comme un dossier de crise permanent, comme un « projet pays » dans le portefeuille de la communauté internationale. Les costumes-cravates des ministres ont été remplacés par les vestes polaires des logisticiens humanitaires. Les lois sont devenues des « cadres logiques », les citoyens des « bénéficiaires cibles ». Bienvenue dans l'ère de l'État-ONG, où la souveraineté s'est évaporée et où le dernier service public qui fonctionne est celui de la mendicité internationale.
2010 : Le Big Bang humanitaire qui a tout dévoré
Le 12 janvier 2010, la terre a tremblé, et avec elle, les derniers vestiges du contrat social haïtien. Dans la poussière et le désespoir, est arrivée une armée de sauveurs. Ils ne portaient pas d'uniformes militaires, mais des badges d'ONG et des casques de chantier. L'aide fut immense, sincère pour beaucoup, mais son architecture fut un poison lent.
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH) fut créée. Une structure monstre, présidée par Bill Clinton pour l'ONU et le Premier ministre haïtien. On y parlait anglais, on y comptait en dollars, et on y décidait du futur d'Haïti en dehors de son Parlement. L'anthropologue Mark Schuller l'a décrypté : l'État fut rétrogradé du statut de souverain à celui de sous-traitant. Pour la première fois, un État acceptait officiellement que son plan de relève ne lui appartienne plus. C'était le coup d'envoi d'une gouvernance par procuration, où l'expertise locale devint superflue, où le ministère des Finances devint un service comptable pour fonds étrangers.
L'assassinat de Jovenel Moïse : l'enquête confisquée, le deuil nationalisé
L'assassinat de Jovenel Moïse en 2021 est le symbole ultime de cette vacance. Le meurtre d'un président en exercice est l'acte de souveraineté criminelle par excellence. La réponse devrait être l'affirmation la plus solennelle, la plus furieuse de l'autorité de l'État.
À Port-au-Prince, ce fut l'inverse. L'enquête fut si immédiatement et ostensiblement prise en main par les États-Unis — FBI en tête — qu'elle en devint une humiliation nationale. Washington détermina les suspects, les narratives, le calendrier. La justice haïtienne était réduite au rôle de spectateur, de greffier pour actes rédigés en anglais. Le message était sans équivoque : « Vous n'êtes même plus capables d'enquêter sur la mort de votre propre président. Laissez-nous faire. » Cette mainmise n'était pas qu'opérationnelle ; elle était métaphysique. Elle signifiait que l'ultime prérogative de l'État — celle de rendre la justice pour son premier représentant — était désormais, elle aussi, sous-traitée.
La grande braderie des fonctions régaliennes
Après 2010, le démembrement devint systématique.
La santé ? Un patchwork de cliniques mobiles gérées par Médecins Sans Frontières ou d'autres ONG espagnoles, françaises ou canadiennes. Le ministère de la Santé publique se transforma en simple coordinateur de donateurs.
L'éducation ? Un chaos où les écoles communautaires financées par des agences françaises et des églises américaines côtoient des programmes de la Banque mondiale. L'État ne fixe plus de cursus national ; il « valide » des projets.
La sécurité ? L'apothéose de la délégation. Face aux gangs qui règnent sur 90 % de la capitale, la réponse de l'État-ONG fut logique : appeler un prestataire externe. D'abord la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) en 2024, puis la Force de suppression des gangs (FSG) en 2025. Des policiers kényans, des soldats jamaïcains, des financements européens. L'État haïtien a admis qu'il n'était plus le détenteur du monopole de la violence légitime, mais son gestionnaire de contrat.
Mark Duffield parle d'une « gouvernance humanitaire » : un système qui ne vise pas à émanciper des citoyens, mais à gérer des populations vulnérables, à contenir les crises pour maintenir un ordre minimal. Haïti en est devenu le laboratoire mondial.
Le Conseil de transition : le gouvernement qui ne regarde pas son peuple
Aujourd'hui, le pouvoir réside dans le Conseil présidentiel de transition (CPT). Cet organe est la parfaite incarnation de l'État-ONG. Il n'a jamais été élu. Sa légitimité ne vient pas des urnes poussiéreuses de Jacmel ou des Gonaïves, mais des courriers de soutien des ambassades et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le CPT ne gouverne pas ; il administre une transition. Son horizon est court (jusqu'à février 2026), ses objectifs sont techniques (organiser des élections), ses comptes à rendre sont d'abord internationaux. Il est l'équivalent parfait d'un directeur pays d'une grande organisation internationale : il applique une feuille de route décidée ailleurs, gère un budget fourni par l'extérieur, et tente de maintenir le calme dans la « zone de projet ».
Robert Fatton l'avait prédit : la dépendance n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Pour une élite, un État faible mais connecté aux circuits de l'aide est plus rentable qu'un État fort mais devant répondre à son peuple. Il y a plus de prestige (et de passeports diplomatiques) dans les salons feutrés de New York que dans les rues brûlantes de Cité Soleil.
Le peuple zombi et l'industrie de la survie
Dans cette équation, le peuple haïtien est le grand oublié, ou plutôt, le grand transformé. Du citoyen porteur de droits, il est devenu le bénéficiaire reconnaissant. De l'électeur souverain, il est devenu la victime vulnérable dont on mesure les « besoins humanitaires ».
Cette transformation tue la politique. À quoi bon débattre de projets de société, de modèles économiques, quand le vrai budget est décidé à Washington ou à Bruxelles ? À quoi bon exiger des comptes d'un Premier ministre dont le poste dépend plus du soutien du Core Group (le club des ambassadeurs) que de la confiance de la rue ?
Le résultat est une société profondément malade. Une défiance absolue envers toute autorité. Un réflexe de survie individuelle qui remplace le sens du collectif. Et, dans le vide laissé par l'État-ONG, l'émergence de pouvoirs sombres : les gangs, qui, eux, offrent une forme perverse de protection, d'emploi et d'identité.
Conclusion : Peut-on ressusciter un État ?
Le drame haïtien contemporain n'est donc pas une simple « crise ». C'est la mise en œuvre réussie d'un modèle : l'État humanitarisé. Un système où la communauté internationale, lasse des turbulences politiques locales, a choisi de financer et de piloter directement la gestion de la misère, court-circuitant les institutions nationales. Un système où les élites locales ont troqué la lourde responsabilité de bâtir un pays contre les privilèges confortables d'intermédiaires grassement payés.
Sortir de ce piège exigera une révolution bien plus profonde qu'un changement de gouvernement. Il faudra :
- Une révolution fiscale : Rétablir l'impôt comme fondement du contrat citoyen. On ne respecte que ce que l'on finance.
- Une révolution de la fierté : Refuser, avec une fermeté non négociable, que la mort d'un président ou la sécurité d'un quartier soient des domaines réservés aux experts étrangers.
- Une révolution de l'aide : Exiger que chaque dollar d'aide passe par le budget national et renforce une institution publique, au lieu de créer une ONG parallèle.
Sinon, Haïti restera cette terre de paradoxe absolu : le berceau de la première révolution antiesclavagiste victorieuse de l'Histoire, devenue le cimetière tranquille de l'idée même de souveraineté. Un pays qui ne produit plus de politiques, mais des appels aux dons. Un État qui n'est plus qu'une grande ONG, attendant, dans l'antichambre des nations, sa prochaine allocation pour survivre.