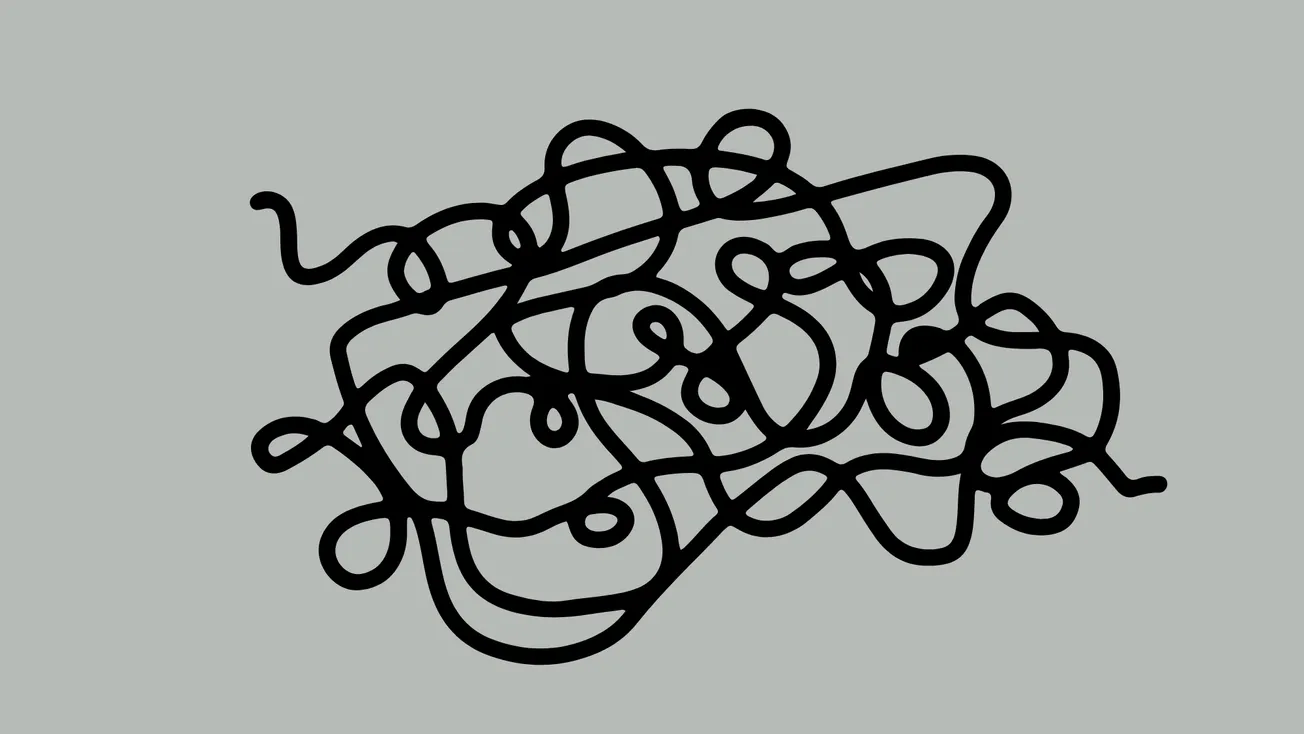Table des matières
I. Introduction
L’essai sur le sens de la neutralité axiologique est une partie de l’ouvrage intitulé Essais sur la théorie de la science de Weber. Dans cet ouvrage posthume réunissant quatre études fondamentales, Weber tente de jeter les bases d’une théorie des sciences sociales. En effet, il faut rappeler que la conception wébérienne de la science influence en grande partie le domaine scientifique et spécifiquement les sciences sociologiques. Dans l’essai sur le sens de la neutralité axiologique, il s’efforce de définir la neutralité ou l’absence de jugement de valeur, le rapport entre l’économie et le politique, ainsi que les présupposés pour une éthique de la science basée sur la neutralité axiologique des professeurs, leur probité intellectuelle et leur réflexivité. Max Weber fait de la neutralité axiologique une constante dans la construction du discours scientifique autonome par rapport aux valeurs. Il ne conteste en aucun cas l’existence d’un rapport aux valeurs qui oriente le choix de l’objet de recherche et de la méthode d’investigation mise en œuvre (Beitone Alain & Martin-Baillon Alaïs, 2016). Le concept de Wertfreiheit, traduit par neutralité axiologique, ne fait pas l’unanimité dans les sciences. Il suscite des débats tant par la position de Weber que par sa traduction. La conception wébérienne fait école tout en construisant des contre-écoles, pour ne pas dire qu’elle génère à bien des égards des mésinterprétations du concept de neutralité axiologique, ayant leur source dans la traduction anglaise value neutrality (Pfefferkorn, 2014). Si tout le débat scientifique est basé sur la séparation radicale entre faits et valeurs, il faut également comprendre le rapport entre faits et valeurs et la complexité que ce rapport met en œuvre.
Dans Le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques, Weber expose sa position en exhortant les professeurs à la nécessité de faire la distinction entre les jugements de valeur et les jugements de fait dans les domaines scientifiques. En ce sens, Weber tend à faire comprendre la non-imposition aux étudiants des valeurs comme vérités. Cette posture wébérienne reste éthique dans la mesure où elle vise à faire des professeurs de véritables scientifiques, dans une construction parfaite d’une responsabilité éthique en accord avec l’éthique de la recherche scientifique. Le contexte allemand de l’époque invite à la prudence. Il faut faire en sorte que la position du professeur ne soit pas imposée aux étudiants comme vérité. À mon sens, tel a été l’objectif de Weber en présentant ce séminaire sur le sens de la neutralité dans les sciences sociologiques et économiques en 1917. La posture de Weber vise à proposer une réponse pouvant servir de base à la question fondamentale : doit-on ou non professer des évaluations pratiques fondées sur une conception éthique, sur des idéaux culturels ou sur une conception du monde ?
Dans ce travail, il sera d’abord question de présenter un résumé succinct du texte, ensuite de faire la part des choses en considérant les critiques du concept de neutralité axiologique, pour enfin conclure sur des perspectives en sciences humaines et sociales par la portée épistémologique et éthique de la neutralité axiologique.
II. Résumé du texte
Le texte est intitulé « Le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques » paru en 1917. Dans ce texte, Weber défend une position éthique sur le rapport entre professeur et corps étudiant. Pour contrôler toute posture politique ou d’imposition d’un discours aux étudiants, Weber présente la neutralité axiologique comme exigence éthique et épistémologique. L’essentiel de la posture wébérienne est de préserver l’autonomie des étudiants.
Dans sa conférence, Weber délimite le concept d’évaluation. Selon lui, l’évaluation est « l’appréciation [Bewertung] pratique d’un phénomène sur lequel notre activité peut exercer une influence en adoptant à son égard une attitude d’approbation ou de désapprobation » (Weber, 1917, p. 6). À partir de cette délimitation, Weber pose le problème de la neutralité en science. Il se questionne sur l’élément central de sa démonstration ou de son argumentation : doit-on ou non professer des évaluations pratiques fondées sur une conception éthique, sur des idéaux culturels ou sur une conception du monde ? Il signale que cette question ne peut être discutée uniquement scientifiquement ; elle dépend des évaluations pratiques, n’en déplaise à des positions extrêmes telles que : 1) la première estime que la distinction entre faits logiques et empiriques d’une part, et évaluations pratiques ou éthiques d’autre part, est justifiée dans une leçon universitaire ; et 2) l’autre position tend à mettre à l’écart les questions pratiques de valeurs.
Weber rejette la deuxième position car, selon lui, la distinction dans les disciplines entre les évaluations pratiques de l’ordre du politique et celles qui ont un caractère autre est absolument irréalisable. De plus, la subjectivité de l’évaluation tend à brouiller les constatations de faits. Ce qui sauvegarderait aussi l’action du pathos authentique sur l’âme des jeunes. La première position est acceptable, même du point de vue subjectif dans le sens wébérien, dans le cas où le professeur se fait un devoir inconditionnel de faire prendre conscience aux étudiants, et ce sans influencer le raisonnement logique ou les constatations de faits empiriques. C’est là un devoir de probité intellectuelle.
À la question de l’obligation ou non de faire des évaluations pratiques en amphithéâtre, Weber croit qu’il s’agit d’une question de politique pratique de l’enseignement supérieur. En ce sens, Weber pense que ceux qui croient que l’université formate de manière politique, culturelle, éthique ou autre adoptent une position différente de ceux qui croient que les professeurs ne peuvent influencer de façon réelle et précieuse qu’en donnant une formation spécialisée se basant sur la qualification des maîtres et leur probité intellectuelle.
En fait, Weber comprend le préjugé favorable du professeur von Schmoller en considérant le contexte de son temps. Toutefois, la génération nouvelle modifie ce type de rapport entre professeur et étudiants. Si autrefois la croyance en l’évaluation pratique et politique parmi les différentes positions était d’ordre éthique, de nos jours, la légitimité de l’exigence éthique des évaluations pratiques se fonde en fonction des prétentions subjectives de la culture par la prévalence du droit à la personnalité du savant. Ce qui justifie une certaine prophétie professorale qu’il faut réfuter dans toute évaluation pratique.
Weber critique les prophètes accrédités par l’État qui s’arrogent le droit de débiter au nom de la science sur des questions touchant la conception du monde en profitant du privilège de l’État d’être en salle de cours, ce qui les met à l’abri de toute discussion et de contradiction. Cela rejoint le principe de Schmoller exigeant le caractère privé de l’enseignement en salle de cours. En dépit des inconvénients de ce principe, Weber partage l’idée que le cours en salle devrait être autre chose et que la sévérité impartiale, l’objectivité et la lucidité d’une leçon professorale ne pourraient avoir les mêmes effets que l’intervention de la publicité du point de vue pédagogique. En effet, l’absence de contrôle ne saurait être assimilée à la pure qualification du professeur spécialiste. Cela n’a aucune raison d’être puisque la spécialisation des prophètes est personnelle. L’absence de contrôle ne doit pas servir à exploiter la condition d’étudiant. L’étudiant doit jouir d’une carrière d’éveil et de formation de ses dons d’intelligence et de sa pensée, ainsi que de l’acquisition de connaissances et d’une conception du monde personnelle.
Le professeur ne doit pas se servir de son titre d’homme de science pour faire passer ses idées politiques ou de politique culturelle. Il peut le faire en public par les voies de la presse, des réunions publiques, des associations, etc.
En ce sens, l’étudiant doit apprendre de ses professeurs : la capacité de s’acquitter avec simplicité d’une tâche, la reconnaissance des faits et le savoir-faire pour distinguer entre constatation des faits et prise de position, ainsi que l’objectivité dans sa démarche.
De cette vision, Max Weber conclut que la tâche ou la cause exige le respect des lois, c’est-à-dire d’exclure tout ce qui est étranger à la cause. Le droit à la réserve constitue une exigence du métier de professeur et d’étudiant. Le culte de la personnalité a des effets multiples. Toute vocation doit s’en dépouiller.
Ainsi, les prétendus adversaires de la liberté de faire en chaire des évaluations politiques évoquent le principe de l’exclusion des jugements de valeur en vue de discréditer les discours sur les problèmes de politique culturelle et sociale en dehors des salles de cours. Ce qui pousse Weber à déduire que les évaluations pratiques seraient justes si elles se font dans l’espace-temps répondant à leurs exigences.
En accordant la possibilité aux professeurs de faire en chaire des évaluations, on déroge à la responsabilité égale de toutes les tendances, même les plus extrêmes. Cela va à l’encontre de la position de Schmoller concernant les marxistes et le groupe de Manchester qui, selon lui, ne sont pas qualifiés pour occuper une chaire universitaire. Cependant, Max Weber n’est pas contre le fait que ceux ayant des positions extrêmes obtiennent une chaire universitaire dans la mesure où ils s’y trouvent placés en vertu de leur conviction objective authentique pouvant permettre de découvrir de nouvelles problématiques dépassant ou échappant à toute évidence en vertu des moyens de leur discipline.
Si la chaire universitaire est un lieu de discussion des questions pratiques de valeurs, il serait obligatoire de considérer tous les points de vue sur les questions fondamentales. Or, la nature des rapports politiques interdit dans les chaires universitaires les discussions sur les problèmes de valeurs pratiques et politiques. Ce qui prime, ce sont les intérêts de la nation.
Max Weber se propose d’analyser le rôle de l’évaluation dans les disciplines empiriques telles que la sociologie et l’économie politique. Toutefois, sa vision n’est plus la séparation de la constatation des faits et de l’évaluation pratique, ce qui pour lui est difficile. En revanche, le schéma stipulant de laisser parler les faits sous prétexte d’éliminer les évaluations pratiques peut, de façon particulière, les suggérer.
Weber estime qu’il faut combattre cette posture selon laquelle l’objectivité scientifique est liée à l’équilibre entre les positions antagonistes. En d’autres termes, il s’agit d’une sorte de compromis politique. La ligne moyenne est peu démontrable en science. La science en général ne peut rendre aux hommes politiques qu’un seul service : leur indiquer face aux problèmes pratiques l’inconciliabilité des positions différentes et ultimes, ainsi que les situations pour prendre des décisions.
À noter que le concept de jugement de valeur suscite des discussions stériles. Il est certain que quand les sciences discutent de jugements de valeur, elles s’occupent des évaluations pratiques et de faits sociaux. La science doit avoir pour finalité des résultats appréciables et évalués objectivement. Ces résultats appréciables signifient le sens de l’intérêt scientifique et subissent des évaluations. Ce qui exige des professeurs de distinguer la constatation des faits empiriques et leur propre position en tant que jugements de valeur sur les faits.
Weber questionne le sens de l’évaluation d’un individu comme base de son action pour être considérée comme fait et pouvoir être objet de critique scientifique. Donc, il n’est plus question de discussion de l’évaluation pratique d’ordre éthique par sa prétention à une dignité normative relevant de la philosophie des valeurs. L’essentiel, c’est de saisir que la validité d’un impératif pratique comme norme et la validité de vérité d’une constatation empirique d’un fait sont deux problèmes hétérogènes si l’on fait fi de leur distinction.
Ainsi, il partage ses points de désaccord avec le professeur Schmoller. Il conteste l’idée de faire de la neutralité axiologique une norme subjective en considérant les variations historiques et singulières lors de prises de position valorisantes. En ce sens, il croit que l’objectivité des constatations de faits est objet de constatation, de même que l’interprétation des faits. Le consensus par convention fait en science un problème et non une solution dans le sens de Schmoller. Cependant, Weber rejette toute idée d’une science-réalité de la morale.
L’essentiel à comprendre dans les discussions qui représentent un avantage scientifique est de saisir les divers motifs dans l’objectif d’une étude empirique causale. De plus, une discussion portant sur la valeur n’a pour intérêt que de saisir la signification que revêt l’objectif pour l’interlocuteur.
L’exigence de neutralité axiologique est liée à la compréhension des évaluations divergentes. Par la position de Schmoller sur les partisans de la neutralité axiologique stipulant que les sciences empiriques ne peuvent connaître que des vérités formelles dans le sens kantien, il faut en fait remettre en question la conception du rapport entre impératif éthique et valeurs culturelles. Les valeurs culturelles sont obligatoires et peuvent entrer en conflit suivant les types de moralités. Les impératifs éthiques et les valeurs culturelles ne sont pas des propositions formelles et n’ont aucun contenu substantiel. Aucune question éthique ne peut être résolue de manière décisive et univoque. D’où le problème fondamental de la justice en rapport avec les questions de politique sociale.
Dans le domaine d’activité personnelle, dit Weber, les problèmes éthiques fondamentaux répondent à l’exigence d’une morale spécifique. La valeur intrinsèque d’une activité est justifiée par la conviction de l’individu. Or, dans le monde social, toute attitude politique révolutionnaire est aussi liée à la conviction. Ce qui répond aux maximes éthiques de la Critique de la raison pratique de Kant.
L’impératif catégorique contient la reconnaissance des sphères de valeurs indépendantes d’ordre extra-éthique, une définition de la sphère éthique par rapport aux autres sphères et la constatation qu’une activité est affectée par des différences dans la dignité éthique. D’où le caractère formel de l’impératif éthique n’indiquant aucun contenu.
Max Weber conclut par la reconnaissance que le polythéisme absolu est la métaphysique convenant aux situations éthiques. C’est-à-dire qu’aucun système conceptuel des valeurs ne peut correspondre à un état des choses. Par rapport aux valeurs pratiques, Weber pense que la philosophie peut saisir leur sens, autrement dit leur structure significative et leur sphère de validité.
Il déduit aussi que les sciences économiques et sociologiques sont indépendantes à l’égard de la théorie des valeurs. Par conséquent, Weber fait remarquer que les discussions portant sur des évaluations ont pour signification de dégager dans leur cohérence interne des opinions divergentes, de déduire les conséquences de la prise de décisions découlant des axiomes et de la pratique d’une position des évaluations pratiques face à un problème, tenant compte des moyens, de l’impossibilité d’éviter les conséquences subsidiaires non voulues, et enfin de dégager de nouveaux axiomes à partir des axiomes en discussion.
Pour ce qui concerne les disciplines scientifiques, leurs problématiques propres ne sont pas des problèmes de valeur. Ce qu’il faut comprendre de ces disciplines est que le « rapport aux valeurs » désigne simplement l’interprétation philosophique de l’« intérêt » spécifiquement scientifique qui commande la sélection et la formation de l’objet d’une recherche empirique (Weber, 1917, p. 25).
Sur l’examen des tendances de développement, Weber souligne qu’aucune science ne peut prétendre les connaître et les saisir. L’adaptation à la tendance au développement reste un problème personnel à résoudre.
La science axiologiquement neutre a pour objectif, face à un problème de point de vue, de le ramener à sa forme logique cohérente et rationnelle afin de déterminer les conditions empiriques de sa formation, ses chances et les conséquences pratiques après expérimentation.
Weber voit l’analyse du progrès et du développement comme très complexe. Le progrès est une question d’opportunité terminologique (différenciation progressive). Cependant, le progrès comme enrichissement progressif ne préoccupe aucune discipline empirique. En histoire de l’art et en sociologie de l’art, il n’existe aucun progrès du point de vue de l’évaluation esthétique. L’évaluation esthétique dépasse l’histoire et la sociologie de l’art comme sciences empiriques.
L’analyse de la naissance de l’art gothique est une solution aux problèmes concrets de construction. Cependant, l’histoire de la musique ne traite pas de problèmes portant sur un progrès technique et rationnel.
Le problème en lien avec l’histoire de l’art est lié à la méthode, soit de contemplation, l’analyse cherchant la causalité ou l’interprétation axiologique. De plus, celui qui, dans une visée empirique de l’histoire de l’art, doit comprendre la production artistique, or cela est inconcevable quand on porte un jugement esthétique.
Donc, on peut parler de progrès dans l’histoire de l’art quand il s’agit de progrès technique et rationnel. C’est la raison pour laquelle la rationalisation et la construction des concepts sont nécessaires aux disciplines empiriques.
Finalement, Weber analyse la théorie économique de Liefmann ; il croit possible de déduire des évaluations univoques. Il admet la portée univoque de la théorie de Liefmann et prend des exemples concernant l’héritage des intérêts comme donnée économique. De plus, il analyse la rentabilité entre capital et travail qui a comme conséquence la bataille de prix entre les couches sociales. La position du professeur est juste en supposant que les intérêts et les besoins sont les mêmes, que le régime de capital privé pour couvrir les besoins est lié à la libre concurrence et au désintérêt de l’État pour le marché. L’univocité d’une évaluation technique dans la sphère économique n’implique pas d’évaluation finale.
Weber, pour finir, analyse la place du rationnel dans les sciences empiriques. Il part de l’idée qu’une chose normativement valable devient objet de recherche empirique en perdant sa validité. Elle relève du domaine de l’étant et non de l’être. La construction rationnelle prend la valeur permettant de faire l’imputation causale, dit Weber. Donc, l’imputation causale des phénomènes naturels implique des constructions rationnelles. Ces constructions de ce genre d’utopies rationnelles sont des formes d’idéaltypes comme constructions conceptuelles.
En ce sens, le savant utilise les idéaltypes pour construire des représentations typiques d’une époque ou construire des convictions conformes aux normes éthiques personnelles mais objectivement justes, pour enfin les comparer à la réalité.
III. Position critique et analyse critique du texte de Weber
La neutralité axiologique comme concept wébérien fait naître des postures théoriques épistémologiques différentes et aussi des controverses dépendant de la finalité politique ou éthique des lecteurs de Weber. Beitone Alain et Alaïs Martin-Baillon (2016) dans leur texte intitulé « La neutralité axiologique en sciences sociales » font ressortir la question de l’impossible neutralité axiologique en se rapportant aux textes de R. Pfefferkorn :
« En témoignent, par exemple, le texte intitulé “Leçons wébériennes sur la science et la propagande” par lequel I. Kalinowski accompagne sa traduction de la conférence de Weber (Weber, 2005), le livre dirigé par D. Naudier et M. Simonet (2011) qui fait l’éloge de l’engagement des sociologues ou l’article publié par R. Pfefferkorn (2014) qui parle d’une impossible neutralité axiologique (p. 2) »
Cette position d’une impossible neutralité rejoint celles de T. Discepolo et d’Alain Caillé qui parlent respectivement de l’impossible neutralité et de l’impossible objectivité. Toutefois, Beitone et Martin-Baillon (2016) croient que le refus de la neutralité axiologique est accompagné du refus du scientisme et du positivisme tendant à séparer les sciences de la nature et les sciences sociales. Ils défendent l’idée de la possibilité et de l’indispensabilité de la neutralité axiologique. Se basant sur cette perspective, nous partons de l’idée que la neutralité axiologique de Weber, en dehors de toute mauvaise traduction du concept allemand en français, n’est plus une question de séparation des jugements de fait et jugements de valeur ; il s’agit, pour reprendre Daoust (2013), d’une exigence éthique ou d’un idéal éducationnel ayant pour base une posture épistémologique. Dans ce cas, il convient de présenter dans un premier temps le versant épistémologique (séparation entre faits et valeurs) pour tirer la conséquence éthique d’une telle posture d’une part, et d’autre part pour faire ressortir la position de Weber sur le sens du rapport aux valeurs et jugements de valeur pour saisir en réalité le sens de la neutralité axiologique chez Weber.
3.1. La question épistémologique / faits et valeurs / jugements de fait et jugements de valeur
Weber, dans l’essai sur le sens de la neutralité axiologique, établit la distinction entre les jugements de valeur et jugements de fait. Il soutient que leurs conditions de validité ne répondent pas aux mêmes principes et méthodes. Les jugements de fait caractérisent les sciences empiriques basées sur l’observation sans pour autant écarter le rapport entre faits et valeurs dans les disciplines. Pour les sciences humaines, les valeurs sont extérieures aux faits, contrairement aux sciences de l’esprit où les valeurs sont liées aux faits. Cette position de Weber ne consiste pas à séparer objectivité et subjectivité dans le sens que l’objectivité est du domaine des sciences naturelles et la subjectivité des sciences de l’esprit. Car selon Weber, toutes les sciences tendent vers l’objectivité. Se basant sur la distinction wébérienne des jugements de valeur et jugements de fait, Daoust (2013) objecte en signalant deux problèmes majeurs : d’une part, la question de l’entrelacement du discours empirique et du discours probabiliste (quantitatif) en sociologie pour comprendre un fait social ou phénomène social ou les activités sociales, car selon Daoust, la posture wébérienne établissant la différence entre les jugements de fait et les jugements de valeur sur la base de conditions de validité réfute l’idée d’entrelacement des discours ; et d’autre part, il croit que la neutralité axiologique ne peut se limiter aux salles de cours et aux groupes de recherche mais doit être appliquée dans toutes circonstances et dans tous les lieux.
3.2. La question éthique de la neutralité axiologique
Se basant sur la portée épistémologique de la distinction wébérienne des jugements de valeur et jugements de fait, il faut finalement comprendre sa portée éthique. Weber analyse le poids ou l’influence que le professeur, par sa méthode d’enseignement, ses pratiques discursives et sa position politique, peut avoir sur les étudiants. Il construit la neutralité comme norme éthique pour préserver l’étudiant de tout processus tendant à le faire se soumettre aveuglément à des points de vue, invite les professeurs à faire preuve de probité intellectuelle et de réflexivité, sources d’autonomie des étudiants. Il préconise en ce sens l’évaluation critique qui participe à la formation de l’autonomie de l’étudiant. Tenant compte du contexte d’apprentissage en Allemagne à l’université, la neutralité axiologique devient une norme éthique. C’est ce qu’en partie ce passage ci-dessous fait comprendre :
« L’aristocratie académique du professeur crée toutes les conditions propices pour convaincre l’auditoire, l’influencer dans le but qu’il accepte une thèse normative. Dans ce type de rapport hiéarchique, le but du professeur n’est pas d’encourager les individus à réfléchir par eux-mêmes de façon autonome, mais simplement de les convertir. C’est tout le contraire de la réflexion rationnelle. Comment pouvons-nous former des penseurs autonomes si nous cherchons simplement à les convaincre ? » (Daoust, 2013, pp. 19-20)
Dans l’optique de faire de la salle un lieu de conversion, la neutralité axiologique comme principe agit pour faciliter l’autonomie de l’étudiant dans le but d’encourager sa réflexion autonome. En ce sens, comme le dit Daoust, la neutralité axiologique est une forme de déontologie du savant. En respectant ce principe ou cette norme, la salle n’est plus un lieu de contrôle où le rapport de force s’enracine, mais un lieu où se construit la réflexivité de l’étudiant dans un processus lui permettant de faire des choix et de fixer sa position dans les débats en lien avec son domaine.
3.3. Rapport aux valeurs et jugements de valeur dans la production des connaissances
Max Weber fait corps avec le principe de neutralité axiologique. Il soutient la construction du discours scientifique autonome par rapport aux valeurs. Il ne conteste pas l’existence d’un rapport aux valeurs qui oriente le choix de l’objet de la recherche et la méthode d’investigation (Beitone & Martin-Baillon, 2016) en se basant sur l’essai sur le sens de la neutralité dans les sciences sociologiques et économiques qu’il définit ainsi : « le “rapport aux valeurs” désigne simplement l’interprétation philosophique de l’”intérêt” spécifiquement scientifique qui commande la sélection et la formation de l’objet d’une recherche empirique » (Weber, 1917, p. 25). La construction de l’objet et la méthode d’investigation du scientifique sont liées aux rapports aux valeurs idéologiques et à la vision du monde du chercheur. Sur la question des évaluations pratiques, Weber ne contraint aucun scientifique à être en tout lieu objectif. Il n’interdit pas aux scientifiques d’avoir une position politique sur des situations ou contextes et de participer aux discussions sur les politiques publiques. Il exige du savant la probité intellectuelle impliquant une réflexivité. En d’autres termes, Weber exige d’évaluer les relations entre rapport aux valeurs et travail scientifique du chercheur. Le chercheur, selon Weber, doit savoir s’identifier lors de sa prise de parole. Comme chercheur, il doit formuler des jugements de fait et, comme citoyen ou homme politique, des jugements de valeur.
L’existence d’un rapport aux valeurs chez Weber n’implique pas la formulation de jugements de valeur. Selon lui, l’orientation de l’objet de recherche et la méthode d’investigation du chercheur doivent déboucher sur des connaissances objectives résultant d’un processus d’objectivation. Les connaissances produites par les chercheurs doivent être évaluées par des chercheurs de rapports aux valeurs différents en vue de dégager la vérité des propositions. En ce sens, avoir des rapports aux valeurs différents est un facteur d’enrichissement de la connaissance chez Weber. Il est contre toute position médiane ou de consensus dans la production de connaissances.
3.4. Neutralité axiologique ou absence de jugements de valeur pour une éthique en science : constats et critiques
La neutralité axiologique est une exigence faite par Weber consistant à éviter la formulation des jugements de valeur dans la production de connaissances scientifiques. Cela fait corps avec les valeurs prônées par la communauté scientifique. Elle est, dans le sens de sa finalité, un moyen d’interdire de faire de l’idéologie dans la science ou de réduire l’influence de l’idéologie, de la vision du monde et des motivations du chercheur. Elle offre la possibilité d’une ouverture à l’éthique de la recherche et dans la production de la connaissance. C’est aussi un outil contre l’instrumentalisation des faits dans le processus de production de la connaissance. Par souci de neutralité, le scientifique se limite à éviter tout jugement de valeur. Chez Weber, la neutralité est une exigence académique, mais aussi scientifique et éthique. L’enfermement de la neutralité dans le milieu universitaire ou académique constitue un problème majeur dans la prise en compte du discours d’un scientifique. Il peut être perçu comme un sujet clivé, partagé en fonction du lieu où il se trouve. Ce qui risque d’invalider ses discours dans les différents espaces. L’exigence de Weber doit dépasser le milieu universitaire et scientifique pour s’étendre dans l’espace public. En ce sens, le chercheur en tout lieu doit porter un discours exempt de jugements de valeur ou accordant la primauté aux jugements de fait pour faciliter un meilleur rapport entre lui et la société par l’intérêt que peuvent porter les gens à son discours.
Par rapport à la neutralité wébérienne, peut-on dire que la science doit être fondée uniquement sur les faits en tant que valeur ? Peut-on vraiment distinguer fait et valeur ? Les jugements de fait ne sont-ils pas la réalisation des valeurs ? Philippe Fontaine est direct dans la compréhension du fait et de la valeur. Il signale d’emblée que la valeur n’est pas un fait mais elle est une exigence de réalisation. La valeur est une sorte d’idée-guide orientant l’action, comme en témoignent les propos ci-dessous :
« Car réfléchir sur la meilleure manière de vivre, ce n’est plus seulement considérer des faits, c’est-à-dire ce qui est, mais définir ce qui doit être (et qu’on appelle des “valeurs”, ce qui “vaut” absolument, et dont la mise en œuvre s’impose à ma pratique). La valeur n’est pas un fait, mais, ce qui est tout autre chose, une exigence de réalisation. Par exemple, si j’ai le malheur de vivre dans un pays totalitaire, la liberté, dont je suis privé (liberté de pensée, d’opinion, d’expression, politique, religieuse, etc.), constitue alors pour moi une valeur fondamentale, qui va être une sorte d’idée-guide orientant et finalisant mon action de résistance à l’oppression. » (2008, p. 12)
Pour aller plus loin, il critique la conception d’une science constituée seulement de faits en partant de la critique de Husserl sur la valorisation des faits comme seule dimension de la science. Par la considération seulement des faits, Husserl croit que l’humanité risque de tomber dans ce qu’il appelle une humanité de fait, c’est-à-dire une humanité sans émotions, déshumanisée, incapable de distinguer les valeurs et les antivaleurs.
« Mais il y a évidemment plus grave, dans cette prétention de la science à vouloir ne considérer que des “faits”, rien d’autre que des faits ; c’est qu’on risque de produire ce que le philosophe Husserl appelle une “humanité de fait”, c’est-à-dire une humanité déshumanisée, froide, insensible, dépourvue de toute émotion, et, ce qui est infiniment plus grave encore, incapable de distinguer entre le bien et le mal, le juste et l’injuste, le désirable et l’indésirable » (Fontaine, 2008, p. 13).
La conception wébérienne, en dépit de sa portée éthique et épistémologique, laisse des points d’ombre et des questionnements de toutes sortes en considérant les avancées scientifiques modernes et contemporaines en sciences humaines et sociales : La complexité de la science peut-elle se baser sur une distinction entre faits et valeurs ? Avec l’interdisciplinarité ou le dialogue entre les sciences, la distinction entre valeurs/faits/jugements de valeur et jugements de fait ne risque-t-elle pas de compromettre tous les efforts des scientifiques ?
L’entrelacement des discours n’est-il pas aussi important pour pouvoir mieux saisir le sens d’un phénomène social ?
Autant de questions possibles pouvant ouvrir des débats sérieux sur la question de la neutralité dans le sens de Weber.
Conclusion
En fait, Max Weber est un scientifique et homme politique qui, de son vivant, fait corps avec sa perspective de neutralité axiologique. Il se distingue en salle de cours comme universitaire et aussi comme citoyen en public. Sa perspective, tout en étant intéressante, ne fait pas l’unanimité de son vivant et même après sa mort. Les débats sur la neutralité axiologique n’arrivent pas toujours à leur terme. Ils invitent toujours à penser davantage sur le concept ou à inventer un concept répondant aux exigences du contemporain. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas participé à faire avancer la science. Pour certains scientifiques et sociologues, la neutralité wébérienne est une norme impossible à atteindre, car distinguer jugements de fait et jugements de valeur semble une tâche difficile. Pour d’autres, la perspective wébérienne est une condition nécessaire et utile pour parvenir à une meilleure production de connaissance, en ce sens que les faits doivent primer sur les valeurs. Toutefois, il faut se rappeler qu’en dépit de la portée épistémologique de la perspective wébérienne, l’objectif de Weber dans Le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques, pris isolément par rapport à ses œuvres, est d’exiger des chercheurs la capacité de réflexivité et de probité intellectuelle. Il faut noter que la neutralité axiologique en tant que non-imposition de valeurs est plus exigeante qu’un simple non-recours à la propagande.
Références
Beitone, A., & Martin-Baillon, A. (2016). La neutralité axiologique dans les sciences sociales. Revue du MAUSS permanente, 18. http://www.journaldumauss.net/./?La-neutralite-axiologique-dans-les-1340
Daoust, M.-K. (2013). La neutralité axiologique, une exigence épistémologique ou éthique? Les Cahiers d’Ithaque, 8-23. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13289
Fontaine, P. (2008). Qu’est-ce que la science ? De la philosophie à la science : Les origines de la rationalité moderne. Recherche en soins infirmiers, 92(1), 6-19. https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2008-1-page-6.htm
Pfefferkorn, R. (2014). L’impossible neutralité axiologique : Wertfreiheit et engagement dans les sciences sociales. Raison présente, 191(3), 85-97.
Weber, M. (1917). Le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques. Dans M. Weber, Essais sur la théorie de la science (traduit de l’allemand par J. Freund). Paris : Plon.
À propos de l'auteur