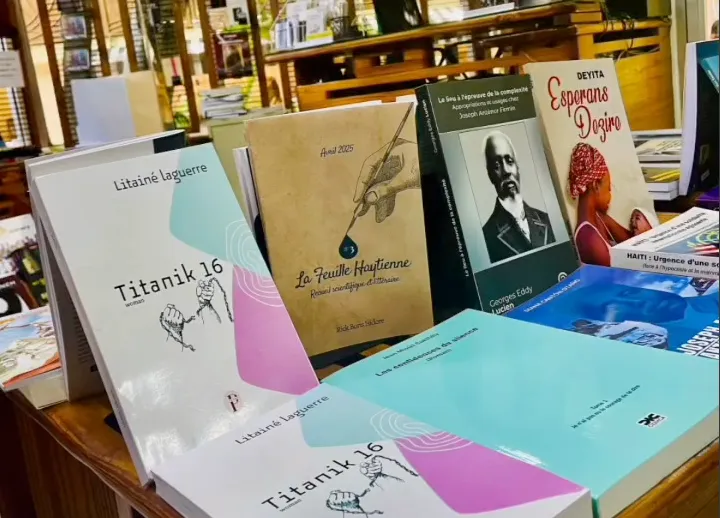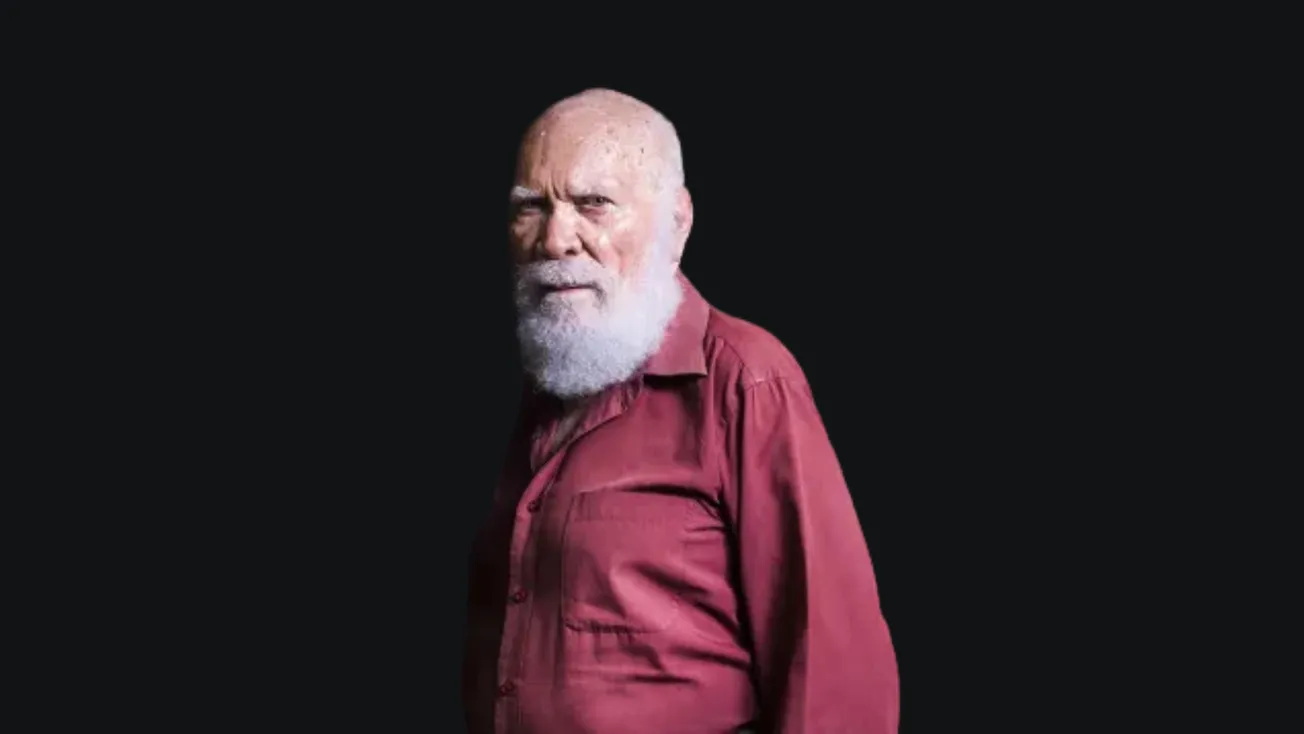Table des matières
Il suffit de passer quelques heures sur les réseaux sociaux haïtiens ou de s’attarder dans une conversation de rue à Port-au-Prince pour s’en rendre compte : dans notre culture, même les tragédies les plus profondes – l’insécurité, la faim, la migration forcée, les catastrophes naturelles, jusqu’à la mort – deviennent matière à rire.
Pourquoi ? Est-ce une forme de résilience, une manière de conjurer le désespoir par le sarcasme, comme le faisaient les esclaves dans les lakou pour survivre à l’oppression ? Relève-t-il d’un humour noir, héritier de la tradition carnavalesque où le rire renversait symboliquement les rapports de pouvoir ? Ou bien révèle-t-il quelque chose de plus troublant : une incapacité collective à affronter la réalité, un réflexe défensif qui finit par nous enfermer dans un cycle d’auto-dérision stérile ?
Le philosophe mexicain Jorge Portilla, dans un essai trop peu connu intitulé La Fenomenología del relajo, offre une clé de lecture précieuse de cette attitude. Pour lui, le « relajo » dépasse la simple blague. C’est une posture existentielle : un moyen d’évacuer la gravité des choses, de fuir la responsabilité et l’engagement à travers le rire. Inspiré par Heidegger et l’existentialisme, Portilla y voit une forme de mauvaise foi collective : en riant de tout, on se dédouane de tout.
« Le relajo, écrit Portilla, n’est pas un humour sain. C’est une manière collective d’éviter la réalité, une ruse qui empêche que l’on prenne les choses au sérieux. »
« Bagay pou nou kriye, se ri n ap ri »
Cette analyse résonne tragiquement avec le quotidien haïtien. On plaisante sur les enlèvements, sur les gangs, sur la corruption des élites. On a vu circuler des blagues racistes à propos de l’arrivée des soldats kényans, des moqueries grossophobes visant Boubouline, des plaisanteries machistes et sexistes, et même des traits d’humour sur les déportations réalisées par Trump. Ces blagues existent vraiment : elles se propagent dans les rues, dans les bus, sur WhatsApp et sur TikTok. La misère devient mème, l’injustice se transforme en sketch, l’effondrement en punchline.
Ce rire semble parfois vital, presque salvateur – une catharsis face à l’absurdité. Mais, à y regarder de plus près, il agit comme un anesthésiant. Il endort la colère qui pourrait nourrir l’action et dissout la solidarité dans un individualisme moqueur.
Même la diffusion illégale de vidéos intimes de sœur Roselande ou de Tikolòn, ainsi que d’autres affaires de violences sexuelles, se transforme en prétexte à railleries. Les sextapes circulent, les commentaires se remplissent d’allusions sexistes, et les femmes victimes ou soupçonnées deviennent des hashtags tournés en dérision. On franchit là un seuil qui dépasse la satire : c’est une stratégie de désengagement, une manière de transformer le tragique en farce pour éviter d’y répondre.
Le problème du relajo, selon Portilla, réside dans cette corrosion de la possibilité même d’un engagement authentique. Lorsque tout devient sujet de moquerie – la politique, la justice, la mémoire, la mort –, plus rien ne mérite d’être pris au sérieux. Alors, plus rien ne semble valoir la peine d’être défendu ou transformé. Le rire cesse d’être subversif : il érige un mur entre soi et le monde, une stratégie de survie qui tourne à l’auto-sabotage. On rit pour ne pas agir, pour ne pas penser, pour ne pas changer – et surtout pour ne pas affronter la part de responsabilité que chacun porte dans le chaos collectif.
En Haïti, ce mécanisme inquiète d’autant plus qu’il s’inscrit dans un contexte d’effondrement institutionnel, de violence banalisée et de désespoir massif. Le relajo agit comme une anesthésie partagée. Et son prix est lourd : à force de tout tourner en dérision, on finit par croire que rien n’a d’importance, que tout est permis, et que le réel n’est qu’un jeu sans responsables.
Portilla ne condamne pas le rire en soi. Il met en garde contre celui qui masque le vide au lieu de le combler. Car il existe une autre tradition du rire en Haïti : celui des lamayòt qui raillaient les colons, des chansons carnavalesques qui dénonçaient les dictatures, de l’humour féroce des rara visant les oligarques. Ce rire-là libère : il rassemble, il éclaire, il pousse à l’action. À l’inverse, le relajo contemporain dissout : il isole, il obscurcit, il démobilise.
Et maintenant, que faire de notre rire ?
En revisitant La Fenomenología del relajo, c’est un miroir critique que l’on tend à la société haïtienne. Derrière la question du rire se cache un choix de société : voulons-nous d’un humour qui nous aide à nous tenir debout pour construire, ou à survivre sans construire ? Le rire haïtien reste-t-il un outil de résistance ou s’est-il mué en soupape de passivité ?
Peut-on rire sans humilier, se moquer sans anesthésier, divertir sans désengager ? Quelle responsabilité portent les créateurs de contenu, les influenceurs, les médias ? Peut-on imaginer une culture où l’humour agit comme levier de transformation plutôt que camouflage de résignation ? Et qui, aujourd’hui, ose encore dire « sa pa komik » sans passer pour un rabat-joie ?
Le relajo n’est pas qu’une forme de rire : c’est une manière d’habiter le monde. Reste à savoir si nous voulons continuer à rire de notre impuissance, ou si nous sommes prêts à rire avec elle pour mieux la dépasser.
Rire, oui. Mais pas n’importe comment. Pas à n’importe quel prix.
À propos de l'auteur