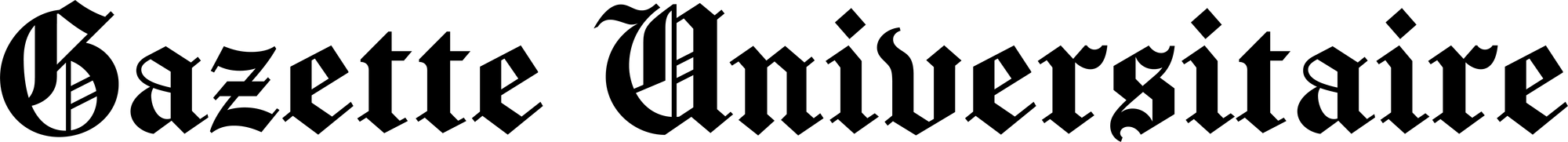Table des matières
Le consentement devient un élément central pour comprendre les enjeux éthiques des décisions prises entre des individus au sein d’un régime de domination et de violence. Il s’agit d’un acte normatif, c’est-à-dire un acte par lequel on modifie les droits et les obligations d’une ou plusieurs personnes. En droit, le consentement se définit comme la rencontre d’au moins deux volontés. L’accord des volontés, souvent précédé de pourparlers, s’analyse comme une offre suivie d’une acceptation.
Cependant, les conditions du consentement soulèvent la question de la domination, notamment lorsqu’on prend en compte les inégalités économiques, sociales et politiques entre les différentes catégories sociales, ainsi que les types de rapports que celles-ci entretiennent dans le cadre même de l’objet du consentement. Max Weber définit la domination comme :
« La domination, c’est‑à‑dire la chance de trouver obéissance pour un certain ordre émis, peut reposer sur différents motifs de docilité : elle peut être purement conditionnée par une configuration d’intérêts, et donc, de la part de celui qui obéit, par des considérations rationnelles en finalité pesant avantages et inconvénients. Elle peut aussi n’être due qu’à la « coutume », à la sourde habitude prise à une manière d’agir profondément intériorisée5 ; ou elle peut avoir des raisons purement affectives, relever de la seule inclination personnelle du dominé. » (Weber, 2014)
Mais une domination reposant uniquement sur de tels fondements serait relativement instable. Chez les dominants comme chez les dominés, la domination s’appuie généralement sur des bases juridiques qui fondent sa « légitimité », et l’effondrement de cette croyance en la légitimité entraîne habituellement des conséquences majeures (Weber, 2014). La domination, à la différence du pouvoir, implique un minimum de volonté d’obéir, une forme d’adhésion, en un mot : un consentement. Certains répliqueront que cette adhésion ne traduit qu’une docilité, une obéissance, une soumission à un ordre perçu comme légitime, auquel on adhère autant par conditionnement que par reconnaissance (Weber, 2014).
Cela rejoint l’analyse que Maurice Godelier développe sur les rapports entre consentement, domination et violence, telle que rapportée par Nicole-Claude Mathieu (2014). Godelier soutient que consentement et violence ne s’excluent pas nécessairement : il n’y a pas de domination sans violence, mais les dominés peuvent néanmoins consentir, car la répression serait moins efficace que l’adhésion. La violence physique aurait ainsi moins d’effet que la conviction, laquelle produit une adhésion volontaire. Mathieu rejette cette lecture. Selon elle, Godelier minimise la violence exercée contre les dominés. Elle insiste sur le fait que cette violence est continue, que les dominés ne sont jamais à leur place légitime et qu’ils sont soumis à un contrôle social constant. Dans ce cadre, elle conteste la possibilité de parler de consentement ou d’acceptation, préférant le concept de « coopération contrainte » (Mathieu, 2014).
Considérant ce débat sur la domination, le consentement et la violence, on peut se demander : comment peut-on véritablement consentir dans un contexte de domination violente ? La domination met-elle en relation deux sujets consentants ou oppose-t-elle un sujet-consentant à un sujet-objet de consentement ? En somme, peut-on parler de consentement éthique chez les sujets dominés dans un contexte de violence imposée par les dominants ?
L’orientation de ce travail découle de cette question centrale : quels sont les présupposés nécessaires pour qu’un consentement soit véritable dans un contexte de domination et de violence ? Nous analyserons, dans un premier temps, les conditions de la domination et son rapport avec la violence. Ensuite, nous établirons le lien entre violence, domination et les normes du consentement. Enfin, nous soutiendrons que dans un régime de violence et de domination, le consentement est une forme d’imposition : il est imposé aux dominés par l’habitus de la domination, car ceux-ci sont placés dans des conditions matérielles qui les contraignent à se plier aux rapports sociaux établis, sans véritable consentement.
Conditions de la domination, de la violence et du consentement
Les conditions essentielles liées à la domination et à la violence, en rapport avec le consentement, sont multiples. Plusieurs éléments doivent être pris en compte, notamment dans le cadre politique spécifique du consentement : la contrainte, les rapports de pouvoir, les rapports sociaux de production et les conditions matérielles d’existence des catégories dominées. Les conditions réelles du consentement sont toujours marquées par la contrainte. Il existe en effet un ensemble de dispositifs politiques qui produisent et facilitent le consentement.
Le rapport de pouvoir entre dominants et dominés réduit considérablement la marge de manœuvre des dominés, même si ceux-ci conservent des possibilités de résistance. La dépendance des dominés vis-à-vis des dominants engendre des concessions de toutes sortes (Coste, Costey & Tangy, 2008). Ainsi, le consentement peut être compris comme une stratégie de cohabitation avec les dominants permettant aux dominés de préserver leur identité. Cette posture a pour effet, bien souvent, de mettre la conscience des dominés en veille. Par ce type de consentement — qui annule leur liberté à travers la violence et ses liens au pouvoir — les dominés s’accommodent de leur condition.
L’acte du colloque Domination, consentement et déni définit la problématique en ces termes :
« En fonction de la place que l’on accorde au sujet et de l’intensité du pouvoir coercitif qui s’exerce à son endroit, on parle de fausse conscience (qui accompagne l’exploitation), de mauvaise foi, de méconnaissance ou bien l’on cherche à articuler des moments pratiques d’oubli, d’aveuglement et des phases réflexives d’interprétation ou d’introspection… » (Coste et al., 2008, p. 1).
Comme on l’a vu ci-dessus, en situation de domination et de violence, les dominés n’existent plus en tant que sujets libres. Ils sont privés de leur liberté, de leur conscience, de leur esprit et de leur corps. Ils ne possèdent plus ce que l’on peut appeler la « propriété de soi ». Ils deviennent des sujets invisibles — autrement dit, des non-sujets. Dans ce contexte, le consentement devient une fabrication. Par le processus d’invisibilisation, les dominés perdent leur qualification en tant que personnes humaines : ils sont réduits au silence, dépossédés de leur identité et exclus de toute forme de parole publique.
En mobilisant les catégories de la reconnaissance, on constate que la violence inhérente à la domination empêche toute reconnaissance des dominés dans l’espace public. Le pouvoir coercitif exercé par les dominants engendre une fausse conscience, construite sur la scène de la domination et présentée comme équivalente à la conscience des dominants. Pourtant, les conditions matérielles d’existence des dominés diffèrent profondément de celles des dominants. Il en résulte une conscience artificielle, façonnée par les dominants pour légitimer l’ordre établi. La conscience des dominés devient ainsi une construction idéologique visant à justifier la domination.
Une autre citation éclaire davantage ces mécanismes :
« La séduction ou la dépendance produit des concessions d’un autre ordre, indispensables pour s’assurer l’accord que la contrainte seule ne saurait garantir. Enfin, le “consentement paradoxal” s’accompagne parfois d’un déni pour préserver son identité, sauver la face, composer avec le cours d’une existence quotidienne. La conscience se met alors “en veille”, l’action devient routine, et le sujet renonce à s’interroger sur les conditions du consentement. En fonction de la place que l’on accorde au sujet et de l’intensité du pouvoir coercitif qui s’exerce à son endroit, on parle de fausse conscience (qui accompagne l’exploitation), de mauvaise foi, de méconnaissance, ou bien l’on cherche à articuler des moments pratiques d’oubli, d’aveuglement, et des phases réflexives d’interprétation ou d’introspection. La psychanalyse, à travers son lexique (dénégation, forclusion,...) permet d’éclairer ces mécanismes. » (Coste et al., 2008, p. 2)
Domination, violence et normes du consentement
Le consentement repose sur des normes partagées entre les sujets impliqués. Pour être valide, il exige, selon plusieurs auteurs, certaines conditions : les sujets en situation de consentement doivent être égaux, responsables, rationnels, et dotés d’une représentation claire et partagée de l’objet du consentement. Surtout, le consentement suppose une volonté libre et autonome des parties concernées.
Les normes du consentement doivent s’appliquer de manière équitable, que l’on soit sujet du consentement ou objet de celui-ci, et ce, même si le consentement peut parfois être un acte unilatéral. L’égalité entre les sujets implique une acceptation mutuelle fondée sur l’autonomie, et non une fabrication sociale issue d’un ordre imposé.
L’autonomie du sujet consentant suppose l’absence de toute forme de violence ou d’influence extérieure au moment de l’acte de consentement. De plus, consentir implique une capacité de délibération rationnelle : cela suppose de pouvoir envisager différentes alternatives et d’évaluer les conséquences de son choix. La responsabilité, quant à elle, engage le sujet dans cet acte : il s’y reconnaît et en assume les effets.
Ruwen Ogien (2007), dans ses principes éthiques, évoque le principe d’égale considération, selon lequel chaque personne doit bénéficier d’une considération égale. Ce principe fonde l’exigence de justice dans les relations sociales et s’oppose radicalement aux dynamiques propres à la domination, où l’égalité est absente de fait.
En analysant les écrits de Nicole-Claude Mathieu, un élément fondamental ressort : la manière dont les sujets perçoivent l’objet du consentement. En contexte de domination et de violence, les groupes sociaux n’ont ni les mêmes représentations ni le même accès à la compréhension de la situation. Les dominants imposent leurs représentations aux dominés, façonnant ainsi une manière d’être, de penser et d’agir qui s’impose aux catégories subalternes.
Dans ce cadre, les sujets ne disposent pas du même niveau de connaissance ou de compréhension de l’objet du consentement. Il en résulte un rapport épistémologique inégal, qui invalide l’idée d’un consentement libre et éclairé. Le déséquilibre des savoirs et des perspectives contribue à renforcer la domination.
La perspective d’Ogien (2007) sur le consentement repose sur un principe fondamental : la liberté de chacun. Pour qu’il y ait véritable consentement, les individus doivent être libres de consentir ou de refuser, sans contrainte.
Or, dans une situation de domination et de violence, cette liberté n’existe pas. Les dominés dépendent d’un autre sujet, souvent en position de décider à leur place, de fixer les termes de leur vie et de leurs projets. Dans de telles conditions, l’imposition remplace le choix, et le consentement n’est plus qu’une apparence : une conformité dictée par la peur, la dépendance ou la nécessité, et non par une véritable volonté libre.
Entre dominants et dominés, le consentement n’est pas possible : céder n’est pas consentir
À partir des critères mêmes qui définissent le consentement, il devient évident qu’un sujet placé sous domination ne consent pas : il cède. Comme le souligne Mathieu (2014), cette cession n’est pas un choix, mais une résignation imposée.
La thèse de Mathieu (2014) devient essentielle pour analyser les limites du consentement en contexte de domination. En effet, la violence structurelle propre aux relations de domination instaure un rapport social qui rend toute possibilité de consentement illusoire. Dans ce cadre, les normes exposées dans la deuxième partie du présent travail — égalité, liberté, autonomie, rationalité — ne peuvent être respectées. En aucun cas, les dominés ne peuvent véritablement consentir : ils se soumettent à la violence des dominants. Ils adoptent les conditions de vie imposées par ces derniers, tout en renonçant à leur propre conscience, afin de maintenir l’ordre social établi.
Une analyse approfondie des normes du consentement montre qu’en situation de violence et de domination, l’égalité entre les sujets est impossible. Les volontés ne sont pas équivalentes : les dominés ne disposent pas de la liberté nécessaire pour choisir ou décider. Et surtout, choisir sous la contrainte n’est pas équivalent à choisir librement. Autrement dit, en contexte de domination, ce que l’on nomme choix n’est souvent qu’un acte de survie, un accommodement stratégique, et non une manifestation d’une volonté libre et éclairée.
C’est en ce sens que Mathieu (2014) affirme qu’on ne peut parler de consentement à la domination que si le sujet dominé y adhère consciemment, par un processus de reconversion subjective dans le cadre même du rapport de domination. Or, ce n’est précisément pas le cas. Chez les dominés, il existe plutôt une forme de négation de l’oppression. Mais cette négation ne constitue pas un consentement. Elle prend la forme du déni ou de la dénégation — deux mécanismes psychiques qui traduisent la difficulté à reconnaître l’oppression, sans pour autant signifier une approbation.
Nicole-Claude Mathieu souligne en outre que ce n’est qu’à partir d’une prise de conscience véritable de la domination qu’un éventuel consentement — c’est-à-dire une adhésion critique et libre — pourrait être envisagé. Mais l’opprimé, dans le système tel qu’il est conçu, est un sujet agi, c’est-à-dire un être agissant sous l’influence d’une structure, sans maîtrise pleine de ses choix. Il n’a pas la même perception de la domination que l’oppresseur. Le système de domination produit les conditions de sa propre reproduction, en rendant invisibles les mécanismes de contrainte et en masquant les inégalités réelles.
Ainsi, la domination nie les conditions mêmes de possibilité du consentement, lequel suppose au contraire la connaissance, la lucidité et la liberté dans la prise de décision.
La perspective de l’éthique du care comme médiation à la violence et à la domination dans le cadre du consentement
L’éthique du care se présente comme une réponse alternative aux théories classiques de la justice sociale défendues par des philosophes occidentaux tels que John Rawls (2009), Amartya Sen (2023) et d'autres. Selon Joan Tronto (2009) et Carol Gilligan (2019), ces théories négligent la place de l’autre dans le cadre d’une politique globale. Autrement dit, elles privilégient une conception de la justice fondée sur les droits individuels, au détriment de la responsabilité envers autrui.
Contrairement à cette logique abstraite du droit, les approches portées notamment par les femmes valorisent la dimension relationnelle : elles privilégient les relations interpersonnelles et cherchent à développer des interactions sociales fondées sur l’attention, la solidarité et le soin. Ainsi, l’éthique du care met l’accent sur la capacité à prendre soin des autres, dans la reconnaissance d’une vulnérabilité commune. Le rapport à autrui devient alors central, dans la mesure où chacun peut être à la fois soignant et soigné.
Cette vulnérabilité partagée ouvre la possibilité d’un engagement solidaire universel. Tronto identifie quatre dimensions fondamentales du care :
- Caring about (se soucier de) : il s’agit de reconnaître un besoin, ce qui suppose une capacité d’attention à autrui, et donc une certaine disposition empathique (Zielinski, 2010).
- Taking care of (prendre en charge) : cela implique d’assumer une responsabilité vis-à-vis du besoin constaté, afin d’y répondre concrètement. La responsabilité devient ici une forme d’efficacité morale (Zielinski, 2010).
- Care giving (donner le soin) : cette étape consiste en la rencontre directe avec autrui dans sa singularité, au moment du soin lui-même.
- Care receiving (recevoir le soin) : enfin, cette dimension invite à tenir compte de la réponse ou de la réception du soin par la personne concernée. Le soin ne peut être complet sans une attention à la façon dont il est reçu.
Partant de cette perspective, une question fondamentale se pose : comment concevoir le consentement dans un contexte de domination et de violence à travers le prisme du care ?
La prise en compte de l’autre, au sens où l’entend Paul Ricœur (1990), consiste à établir des relations « avec et pour autrui », au sein d’institutions justes. Dans cette perspective, la reconnaissance de la vulnérabilité partagée réduit la légitimité de la violence dans les rapports humains. L’autre est alors perçu comme un semblable : on ne saurait lui infliger ce que l’on refuserait pour soi-même.
La vulnérabilité d’autrui devient ainsi le miroir de sa propre vulnérabilité. Prendre soin, dans cette perspective, suppose l’instauration de conditions d’égalité des possibilités. Mais l’éthique du care ne nie pas la différence : au contraire, elle l’intègre comme une richesse. Être différents ne signifie pas se rejeter, mais reconnaître la pluralité comme fondement de la solidarité. C’est dans l’acceptation de la différence que chacun construit son identité.
Pour reprendre la pensée de Derrida (1994, 2014), la reconnaissance de la différence est même la condition du consentement. Elle permet de dépasser une logique d’homogénéité et d’appropriation pour entrer dans un rapport éthique fondé sur la responsabilité.
Dans cette optique, la responsabilité envers autrui implique une reconnaissance de ses besoins, de sa dignité et de sa liberté. Ainsi, la vulnérabilité d’un individu appelle la considération de l’autre, d’où découle une responsabilité réciproque. Cette logique relationnelle permet de penser la violence et la domination non plus comme des éléments constitutifs des relations sociales, mais comme des accidents — des ruptures du lien de soin.
Enfin, l’intégration de l’éthique du care dans les rapports sociaux permet d’imaginer de nouveaux modes de relation entre les sujets : des rapports d’égalité dans la différence. La domination n’est alors plus perçue comme le principe structurant des relations sociales, mais comme un écart, une exception. En valorisant la différence sans en faire un prétexte de hiérarchisation, la société peut se construire sur une base de considération mutuelle et de solidarité active. Vivre en société, c’est ainsi entretenir des relations fondées sur le soin et la reconnaissance de l’autre.
Conclusion
La relation entre violence, domination et consentement s’avère particulièrement complexe à expliciter. Elle soulève même la question — souvent utopique — de la possibilité d’une société dépourvue de toute forme de domination ou de violence. Pourtant, une chose semble certaine : aucun consentement véritable n’est possible en situation de violence et de domination.
En effet, dans de telles conditions, les sujets impliqués ne sont ni égaux, ni libres, ni rationnels au sens des normes classiques du consentement. Ils n’ont pas accès aux mêmes ressources, ni aux mêmes rapports au pouvoir ou au savoir. Le rapport coercitif qui s’installe entre dominants et dominés exclut toute forme de consentement libre. Pour reprendre Mathieu (2014), les dominés ne font que céder à la domination — ils ne consentent pas, car ils n’en ont ni la possibilité réelle ni les conditions subjectives. Leur silence, leur soumission ou leur collaboration ne sont que les effets d’un ordre qui nie leur statut de sujets autonomes.
Dès lors, si l’on veut instituer les conditions du consentement dans une société juste, il est impératif d’égaliser les rapports de pouvoir. Les individus doivent pouvoir être audibles dans l’espace public, c’est-à-dire reconnus comme des sujets dotés de liberté, de volonté et d’autonomie. Sans cette reconnaissance, toute prétention au consentement demeure illusoire.
Dans cette perspective, l’éthique du care constitue une réponse pertinente, en ce qu’elle reformule les conditions du lien social autour de la responsabilité, de la sollicitude et de la prise en compte de la vulnérabilité commune. En considérant l’autre comme un alter ego, c’est-à-dire comme un autre soi-même, il devient possible d’imaginer une société fondée sur des rapports de solidarité, et non sur la domination ou la violence.
Ce changement de paradigme repose sur une reconnaissance active de la vulnérabilité de chacun comme une vulnérabilité partagée. En ce sens, la solidarité, et non la contrainte, devient la voie privilégiée pour répondre aux besoins sociaux — en particulier ceux liés au soin. Ainsi, c’est en construisant une éthique relationnelle fondée sur l’égalité dans la différence, le respect mutuel et le souci de l’autre que l’on pourra rendre possible un consentement véritable, dégagé des logiques de soumission.
Références
Coste, F., Costey, P., & Tangy, L. (2008). Consentir : Domination, consentement et déni. Tracés. Revue de Sciences humaines, (14), 5‑27. https://doi.org/10.4000/traces.365
Derrida, J. (1994). Politiques de l’amitié. Galilée.
Derrida, J. (2014). L’écriture et la différence. Seuil.
Gilligan, C. (2019). Une voix différente : La morale a-t-elle un sexe ? Flammarion.
Mathieu, N.-C. (2014). L’anatomie politique 2. Usage, déréliction et résilience des femmes. Paris : La Dispute.
Ogien, R. (2007). L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes. Paris : Gallimard.
Rawls, J. (2009). Théorie de la justice. Seuil.
Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Seuil.
Sen, A. (2023). L’idée de justice. Flammarion.
Tronto, J. C., Maury, H., & Mozère, L. (2009). Un monde vulnérable : Pour une politique du care. La Découverte.
Weber, M. (2014). Les trois types purs de la domination légitime (É. Kauffmann, Trad.). Sociologie, 5(3). https://doi.org/10.4000/sociologie.2387
Zielinski, A. (2010). L’éthique du care. Études, 413(12), 631‑641.