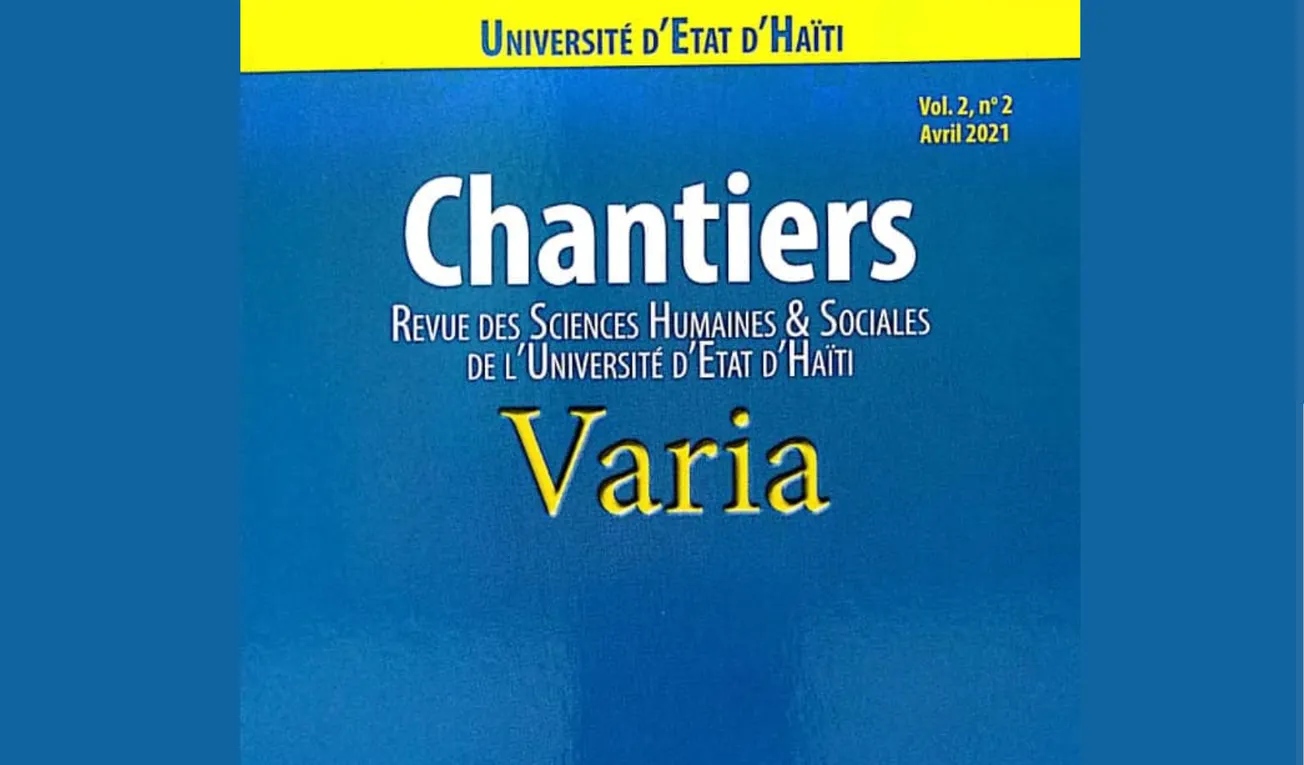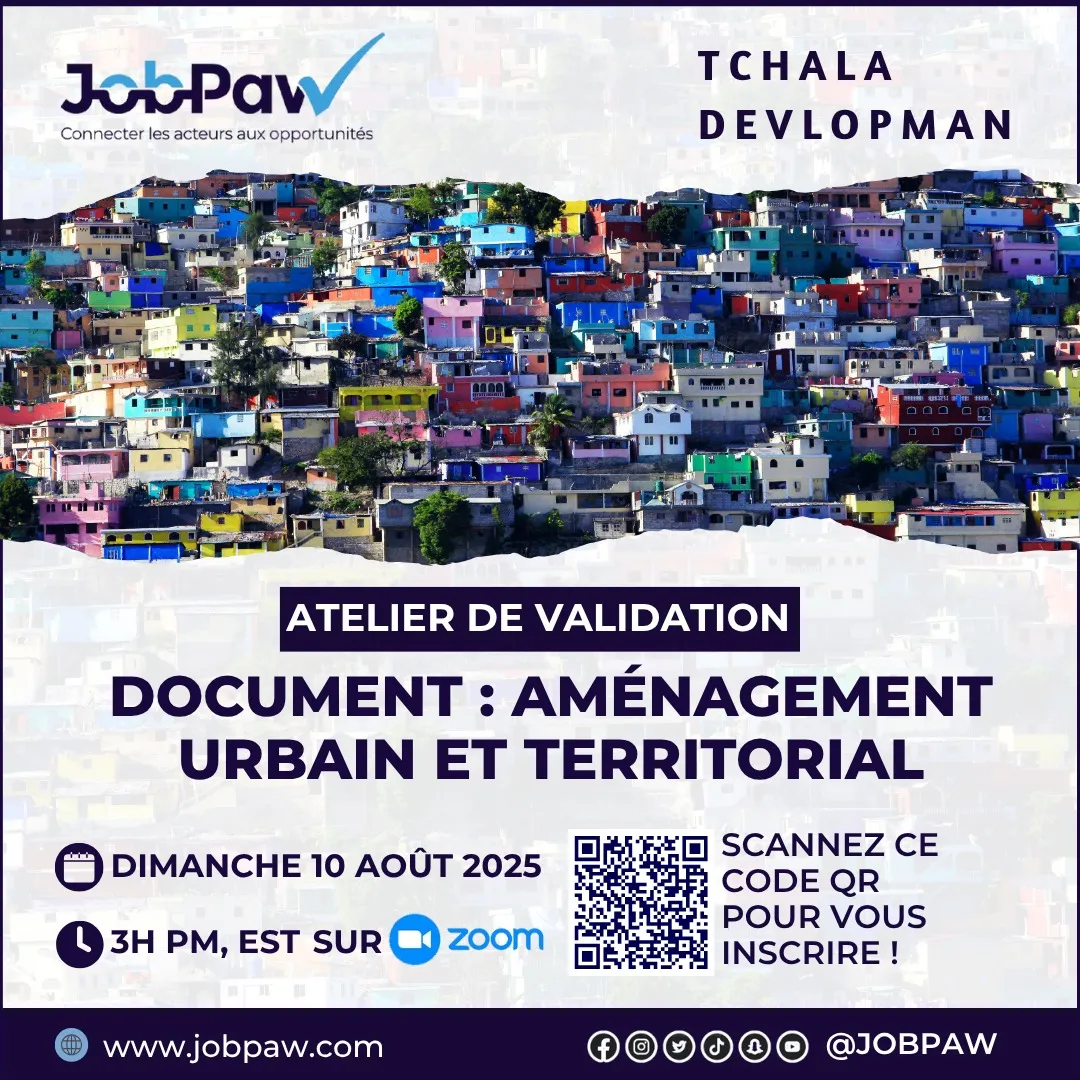Table des matières
Une équipe de recherche du Centre de recherche interdisciplinaire et de valorisation des savoirs sur Haïti (CRIVASH) a publié en 2025 les résultats d'une évaluation de la souveraineté alimentaire menée à Massabielle, commune de Limbé, dans le département du Nord d'Haïti. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la Politique nationale de souveraineté et sécurité alimentaires adoptée par le gouvernement haïtien en 2018.
Contexte d'une crise nationale
Cette recherche prend place dans un contexte national marqué par une crise humanitaire sans précédent. En octobre 2025, plus de 5,7 millions de personnes en Haïti font face à une insécurité alimentaire aiguë, un record historique. La violence généralisée, particulièrement à Port-au-Prince où près de 90% du territoire est contrôlé par des groupes armés, entrave la production agricole et l'acheminement des denrées vers les marchés. Plus de 1,3 million de personnes sont déplacées et l'accès à l'aide humanitaire demeure limité dans de nombreuses régions.
Le département du Nord, où se situe Massabielle, bien que relativement épargné par les violences de la capitale, n'échappe pas à la crise alimentaire qui touche l'ensemble du pays. Cette étude documente la situation dans une communauté rurale où l'agriculture demeure l'activité économique principale malgré des obstacles considérables.
Méthodologie
L'enquête a été réalisée entre juin et juillet 2024 auprès de 29 participants, dont 17 femmes et 12 hommes âgés de 25 à 74 ans. La méthodologie repose sur un outil d'évaluation développé de manière collaborative par des chercheurs haïtiens et canadiens avec des partenaires communautaires. Cet outil examine plusieurs dimensions : l'accès aux ressources, la sécurité alimentaire, les relations de pouvoir, l'environnement, la santé, le genre et la culture alimentaire.
Systèmes agricoles et accès aux ressources
Les résultats révèlent que l'agriculture demeure l'activité économique principale pour 90% des participants. Les ménages comptent en moyenne 8,8 personnes partageant le même repas. L'accès à la terre reste limité, avec des parcelles variant de 0,25 à 6,5 acres, souvent dispersées et sans titre de propriété formel. Seulement 5% des terres en Haïti sont formellement enregistrées.
L'enquête documente plusieurs obstacles à la production agricole : 70% des participants identifient le manque d'accès à l'eau et à l'irrigation comme contrainte majeure, 75% signalent des difficultés d'accès aux semences, et 97% citent les changements climatiques comme menace. L'absence d'infrastructures de stockage affecte 90% des participants, les obligeant à consommer ou vendre immédiatement leur récolte.
Insécurité alimentaire et stratégies d'adaptation
Tous les participants rapportent une insuffisance alimentaire dans leur communauté. Plus de la moitié déclarent avoir des difficultés à accéder à la nourriture, et 57% vivent un stress quotidien. Les stratégies d'adaptation incluent la réduction des portions, le saut de repas et le recours à des aliments de moindre qualité.
Malgré cette situation, 62% des participants affirment produire eux-mêmes l'essentiel de leur alimentation. Cependant, la combinaison de contraintes structurelles et climatiques limite la production et expose les familles à des périodes de soudure particulièrement difficiles. Un participant résume cette réalité : « En raison du manque d'équipement et de moyens financiers ainsi que des sécheresses fréquentes, nous ne disposons pas de la nourriture nécessaire dans notre communauté. Certaines familles ne peuvent pas se nourrir après avoir perdu leur récolte. »
Transformation des systèmes alimentaires
L'étude met en lumière l'impact des politiques commerciales sur les systèmes alimentaires locaux. Les participants observent une présence accrue de produits importés sur les marchés et expriment des inquiétudes quant à leur qualité. La consommation de riz a triplé depuis les années 1990, alors que ce produit est désormais principalement importé. En parallèle, 66% des participants s'inquiètent de l'érosion des pratiques agricoles traditionnelles et de la perte de certaines cultures comme le mil et le riz local.
Les participants décrivent des changements alimentaires significatifs : « Avec l'arrivée des produits importés dans la communauté, les gens mangent du riz tous les jours. » Cette transformation s'accompagne d'une stigmatisation des aliments locaux, 40% des participants indiquant que la pression sociale les pousse parfois à privilégier les produits importés.
Santé et alimentation
Concernant la santé, aucun participant ne se déclare en excellente santé et la moitié fait face à des problèmes de santé persistants. L'anémie représente une préoccupation majeure pour 73% des participants, particulièrement chez les femmes. Les maladies liées à l'eau contaminée, notamment le H. Pylori et la typhoïde, sont fréquemment mentionnées. L'accès limité aux infrastructures sanitaires aggrave ces problèmes : 29% des participants n'ont pas de latrines à domicile.
L'analyse révèle des inégalités de genre dans la distribution alimentaire au sein des foyers. Les femmes préparent les repas mais les hommes bénéficient d'une priorité dans la distribution et reçoivent des portions plus importantes. Cette dynamique peut contribuer aux taux élevés d'anémie chez les femmes haïtiennes.
Culture alimentaire et identité
Les participants expriment leur attachement aux aliments traditionnels et locaux, qu'ils associent à la santé et à la force. Un participant affirme : « Si c'est de la nourriture kreyòl [haïtienne], nous savons que c'est bon. » Les connaissances nutritionnelles proviennent principalement des savoirs familiaux transmis par les générations précédentes. « C'est un héritage que nos grands-parents nous ont laissé. »
Cependant, 40% indiquent que ces aliments sont trop coûteux et signalent une stigmatisation sociale à l'égard de certains produits locaux. Malgré ces défis, 60% souhaitent préserver les aliments traditionnels, y voyant un élément d'identité culturelle. Les aliments les plus consommés incluent le lam veritab (fruit à pain), l'igname, la patate douce et la banane plantain.
Aide alimentaire et perceptions
L'étude souligne l'absence de programmes d'aide alimentaire dans la région malgré l'insécurité alimentaire élevée. Les participants manifestent une méfiance envers l'aide alimentaire, 96% estimant que les aliments fournis par les organisations non gouvernementales ne sont ni sains ni adaptés aux besoins de la communauté. « L'aide alimentaire contient des substances chimiques nocives pour la santé », affirme un participant.
Cette méfiance s'inscrit dans un débat plus large sur l'efficacité de l'aide alimentaire en Haïti. Les participants appellent plutôt à un soutien qui renforcerait la production locale et l'agriculture paysanne.
Environnement et changements climatiques
Les participants établissent des liens directs entre environnement et alimentation. « C'est l'environnement qui nous nourrit. S'il est malade, la nourriture le sera aussi. » L'enquête documente plusieurs défis environnementaux : sécheresses, érosion des sols, inondations, augmentation des températures et émergence de nouveaux ravageurs qui affectent les cultures.
Les changements climatiques sont identifiés comme une menace majeure par 97% des participants. Un participant résume : « Le changement climatique transforme notre système alimentaire. Il réduit la quantité de production locale.»
Perspectives et recommandations
Les auteurs concluent que cette approche par la souveraineté alimentaire offre une perspective plus complète que les évaluations traditionnelles de sécurité alimentaire. Elle permet de documenter les liens entre alimentation, environnement, santé, relations de pouvoir et culture. Les participants identifient les paysans comme principaux acteurs de résolution des problèmes alimentaires de la communauté et appellent à un soutien accru pour l'agriculture paysanne, incluant l'accès à l'eau, aux semences, aux outils, à la terre et aux services de vulgarisation agricole.
Les participants proposent également des mesures pour protéger les aliments traditionnels : sensibilisation à leur valeur nutritionnelle, promotion auprès des jeunes générations, création de centres agro-alimentaires célébrant ces aliments, et politiques limitant l'invasion de produits importés.
Ce rapport, disponible en anglais, en français et en créole, constitue un exemple d'application de l'outil d'évaluation de la souveraineté alimentaire développé par CRIVASH, disponible pour utilisation dans d'autres contextes. Dans un pays où plus de la moitié de la population fait face à une insécurité alimentaire aiguë, cette recherche contribue à documenter les réalités locales et les aspirations des communautés rurales pour des systèmes alimentaires durables et culturellement appropriés.