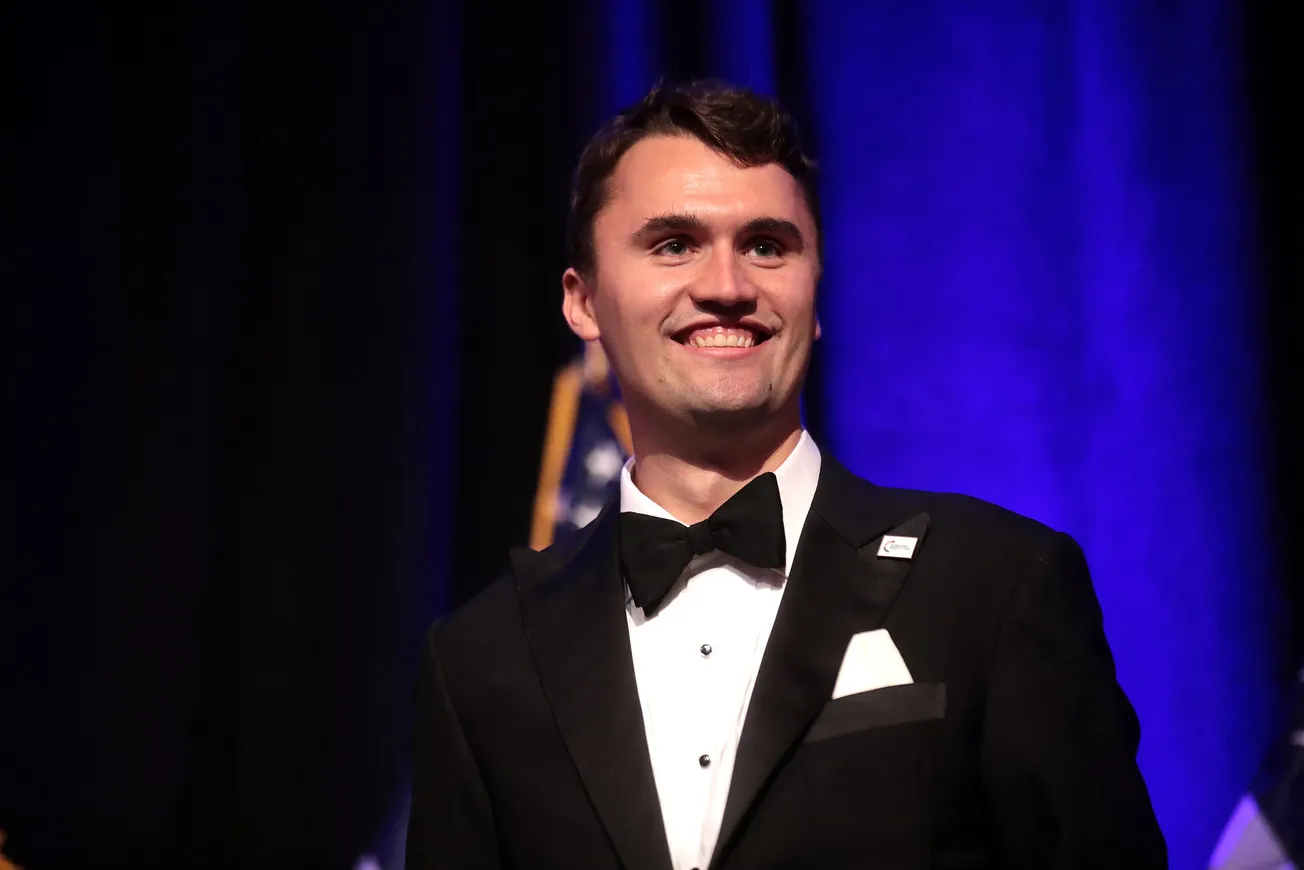Table des matières
Un rapport alarmant révèle l'ampleur des VBG dans un contexte de crise sécuritaire, avec les femmes adultes représentant 77% des victimes
PORT-AU-PRINCE, Haïti — Les violences basées sur le genre (VBG) atteignent des niveaux catastrophiques en Haïti, avec 6 269 incidents rapportés entre janvier et juillet 2025, selon un rapport du sous-cluster VBG coordonné par l'UNFPA et le ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes.
Ces chiffres, compilés par 27 organisations humanitaires actives dans le pays, révèlent une réalité particulièrement préoccupante : 75% de ces violences sont perpétrées par des membres de gangs armés, illustrant l'intersection tragique entre l'effondrement sécuritaire et les violences de genre.
Les femmes adultes représentent 77% des victimes (4 801 cas), suivies par les filles de moins de 18 ans (14% soit 862 cas). Les hommes adultes constituent 8% des victimes (522 cas), tandis que les garçons de moins de 18 ans représentent 1% (84 cas).
Le viol et la pénétration forcée dominent les statistiques avec 47% des incidents rapportés, suivi des violences psychologiques (24%) et des agressions physiques (13%). De manière particulièrement alarmante, 62% des viols signalés sont des viols collectifs, témoignant de l'extrême brutalité de ces crimes.
L'analyse géographique révèle que le département de l'Ouest, qui inclut la capitale Port-au-Prince, concentre 2 704 incidents soit la majorité écrasante des cas. L'Artibonite suit avec 405 incidents, tandis que le Centre en compte 185 et la Grande-Anse 98.
Lire aussi

Les données sur les lieux d'occurrence sont particulièrement révélatrices : 47% des incidents se produisent au domicile de la victime, 23% sur la route ou dans la rue, et 6% au domicile de l'agresseur. Cette répartition souligne que même l'espace privé n'offre plus de protection aux femmes et aux filles haïtiennes.
Le statut de déplacement des victimes illustre l'impact de la crise : 69% sont des déplacés internes, 30% des résidents, et 2% des migrants. Cette surreprésentation des déplacés internes parmi les victimes témoigne de leur vulnérabilité particulière dans un contexte où plus de 700 000 personnes ont été forcées de fuir leurs foyers.
L'accès aux soins révèle des défaillances critiques du système de prise en charge : seulement 25% des cas de viol ont été traités dans les 72 heures suivant l'incident, période cruciale pour la prophylaxie post-exposition et la collecte de preuves médico-légales. À l'inverse, 24% n'ont été pris en charge qu'un mois après l'agression.
Le rapport détaille également la répartition des services de référencement : 831 personnes ont bénéficié de services médicaux, 809 d'un soutien psychosocial, 467 ont été orientées vers des services d'hébergement temporaire, et 200 ont reçu une assistance juridique.
Malgré ces efforts, les besoins demeurent immenses. Le sous-cluster VBG ne dispose que de 3,39 millions de dollars sur les 19 millions requis, soit un déficit de financement de 82%. Cette pénurie de ressources limite drastiquement la capacité de réponse dans un contexte où 1,5 million de personnes ont besoin de services de protection contre les VBG.
Lire aussi

Les organisations présentes sur le terrain incluent des ONG nationales (40% des acteurs), des ONG internationales (36%), des organisations de société civile (16%) et des agences onusiennes (8%). Parmi les 44 partenaires actifs, 559 agents publics et humanitaires ont été formés aux normes minimales de préparation et de réponse aux VBG.
Ces données confirment que les violences basées sur le genre constituent l'une des manifestations les plus dramatiques de la crise haïtienne. Dans un contexte où les gangs contrôlent environ 60% du territoire de Port-au-Prince, les femmes et les filles payent un prix disproportionné, devenant les victimes collatérales d'une guerre que ne dit pas son nom.
La coordinatrice du sous-cluster VBG, Blandine Afanda de l'UNFPA, et la directrice des droits des femmes au MCFDF, Evelyne Bien-Aimé, travaillent avec les partenaires internationaux pour renforcer la réponse, mais les défis demeurent considérables face à l'ampleur de la crise.
Ces statistiques, bien qu'alarmantes, ne représentent probablement qu'une partie de la réalité, de nombreux cas demeurant non rapportés dans un contexte où l'accès aux services demeure limité et où la stigmatisation sociale décourage encore de nombreuses victimes de témoigner.
Lire aussi